Peut-on avoir une idée des risques que nos activités, notre économie, notre bien-être, et donc nous les être-humains, encourons en raison de la perte des bénéfices, gratuits, invisibles, implicites, que nous retirons de la biodiversité ? À travers la plupart de ses activités essentielles, l’être humain tire des bénéfices et impacte de nombreux fonctionnements naturels tels que le cycle de l’eau, la pollinisation, la production alimentaire ou encore la régulation des maladies. Ces mécanismes et leurs conséquences sont multiples et complexes : impacts économiques, sociaux, sur la santé humaine, etc. Ils font l’objet de nombreuses publications scientifiques visant à mieux les comprendre et les prendre en compte.
Concernant les pratiques agricoles, la majorité des études recensées s’intéresse à l’impact des pratiques mises en oeuvre à l’échelle du paysage telles que le changement d’usage des sols, l’intensification des cultures ou de l’élevage. Les pertes de services les plus étudiées liées à ces pratiques sont les services de régulation des processus environnementaux, notamment des organismes et de pollinisation. Les conséquences de ces pertes les plus recensées sont sur des variables économiques, en particulier la productivité et les rendements agricoles, et environnementales, plus précisément la perte cumulée de services écosystémiques. La perte de services écosytémiques peut également avoir des conséquences sur la qualité des sols ou de l’eau et peut entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine, allant de la malnutrition à l’augmentation des épidémies.
Zoom sur les lacunes de connaissances
Au niveau des pratiques agricoles. L’impact de certaines pratiques est très peu étudié, notamment l’effet du labour, de même que l’impact des systèmes de production agricole.
Au niveau des services écosytémiques. Les services d’approvisionnement (énergie, alimentation humaine et animale, ressources médicinales, biochimiques et génétiques) et d’apports immatériels (apprentissage et inspiration, expériences physiques et psychologiques, soutien identitaire) sont les moins étudiés.
Au niveau des conséquences pour les humains. Les externalités sociales et de santé sont peu présentes dans la littérature scientifique.
Dans les écosystèmes marins, au cours des cinquante dernières années, la pêche est l’activité ayant l’impact direct le plus important sur la biodiversité, que ce soit au niveau des espèces ciblées, non ciblées ou des habitats. Aujourd’hui, l’expansion de l’aquaculture vient renforcer cette pression.
Les externalités négatives étudiées liées à ces pratiques sont de natures :
À l’occasion de ce lancement, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ?
Ces exemples illustrent comment les crises liées au changement climatique, à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à l’alimentation sont indissociables. Chacune de ces dimensions est une pièce du puzzle qui façonne notre avenir. Il est devenu essentiel de comprendre que les perturbations dans l’une d’entre elles entraînent des répercussions immédiates sur les autres.
La disparition des chauves-souris au nord des États-Unis provoque des effets en chaîne sur l’agriculture, l’économie et la santé publique. Leur rôle crucial dans la régulation des insectes est irremplaçable : sans elles, les agriculteurs ont intensifié l’utilisation d’insecticides, bien moins efficaces. Résultat : une baisse de la qualité des récoltes, une perte de 28,9 % des revenus agricoles (26,9 milliards de dollars) et des conséquences délétères sur la santé infantile. Les dommages combinés pour l’agriculture et la santé s’élèvent à 39,4 milliards de dollars. Ce lien de causalité illustre l’interdépendance entre biodiversité et bien-être humain.
Article source :
Eyal G. Franck et al. (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science
Le gaspillage alimentaire, qui comprend les pertes à différents stades de la chaîne d’approvisionnement — production, manutention post-récolte, transformation, et distribution — a des conséquences écologiques et sociales importantes. Réduire ce gaspillage de moitié permettrait de préserver 12 % des ressources mondiales en eau, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 4 %, et nourrir jusqu’à 1,9 milliard de personnes supplémentaires. Ces chiffres illustrent le lien de causalité entre nos habitudes de consommation, les pertes alimentaires et l’épuisement des ressources planétaires.
Article source :
Kummu et al. (2012) Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. Science of the Total Environment
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.092
L’eau douce, la biodiversité, la santé humaine, le changement climatique et la sécurité alimentaire forment un réseau de relations interdépendantes. La surexploitation de l’eau pour l’agriculture entraîne une dégradation des écosystèmes aquatiques, accentuée par la pollution chimique et l’introduction d’espèces invasives. Ces pratiques contribuent au changement climatique, qui, à son tour, exacerbe la perte de biodiversité et fragilise la sécurité alimentaire. En retour, cette fragilité accroît les risques pour la santé humaine, soulignant un cercle vicieux où chaque perturbation alimente les déséquilibres globaux.
Article source :
Carpenter et al. (2011) State of the World’s Freshwater Ecosystems: Physical, Chemical, and Biological Changes. Annual Review of Environment and Resources
DOI : 10.1146/annurev-environ-021810-094524
Les récifs coralliens, sous la pression croissante du changement climatique, subissent une dégradation alarmante. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, fournissant des ressources à des millions de personnes. Leur déclin entraîne une diminution des services écosystémiques, compromettant les stocks de poissons et les moyens de subsistance des communautés côtières, tout en fragilisant les équilibres environnementaux globaux.
Article source :
Hughes et al. (2017) Coral reefs in the Anthropocene. Nature
Le changement global, lié au climat et aux impacts anthropiques directs, entraîne une redistribution des espèces marines à travers le monde, modifiant la composition taxonomique des communautés et de leurs traits. Ces changements peuvent avoir de forts impacts sur la biodiversité des poissons et les services écosystémiques associés. Cependant, notre capacité à évaluer et à suivre les changements à court et à long terme de la distribution des espèces et leur biodiversité au niveau local à global est entravée par la disponibilité et l’hétérogénéité des données.
Cette conférence organisée par le FRB-Cesab a présenté les activités du groupe de travail Fishglob, qui a collecté et combiné un ensemble de données unique provenant de campagnes scientifiques de chalutage effectuées régulièrement au cours des dernières décennies à travers le monde. Les sujets abordés ont inclu le groupe de travail Fishglob et les caractéristiques de leurs données, la méthode d’imputation pour les traits d’espèces manquants, les évaluations de la liste rouge, les effets des vagues de chaleur marine, l’homogénéisation/différenciation des assemblages d’espèces au fil du temps, les conséquences sur les stocks de poissons partagés entre les pays et la gestion des pêcheries
Pour finir, Fishglob visait à fournir une infrastructure renforçant la coopération internationale et le transfert de connaissances entre les fournisseurs de données, les scientifiques et les parties prenantes afin de soutenir l’adaptation de la gestion de la biodiversité et des pêcheries en période de changement global.
Vous avez raté la conférence ? Vous souhaitez (re-)voir une présentation ? L’intégralité de la conférence est disponible sur la chaîne Youtube de la FRB !
Qu’est-ce que le projet PEPR ATLASea ?
Avant de s’intéresser à le définir, il est important de comprendre pourquoi il est important ! Les approches systématiques sont cruciales afin de dresser des inventaires de biodiversité, notamment pour obtenir des génomes. Le génome est comme une pelote de laine compacte dans le noyau des cellules, où chaque fil d’ADN porte des instructions qui codent le vivant. Séquencer un génome, c’est dérouler et enregistrer toutes ces informations.
Au niveau international, l’échelle génomique est en pleine activité, avec des nombreux projets globaux tels que :
C’est dans ce cadre, en tant que contribution dans ces initiatives plus générales, que la France a choisi de participer à l’effort international en lançant un PEPR (Programme et Équipement Prioritaire de Recherche). Ce dispositif français, dédié au financement de la recherche publique, s’inscrit dans le plan France 2030. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour le programme ATLASea, dont l’objectif est de séquencer, sur une période de huit ans, le génome de 4 500 espèces marines de métropole et des territoires ultramarins.
Ce projet AtlaSEA est coordonné par Hugues Roest Crollius, chercheur au CNRS et Patrick Wincker, directeur du Génoscope. Le Génoscope est le centre national de séquençage qui s’est chargé il y a plus d’une vingtaine d’années du génome humain et qui est désormais largement tourné vers le séquençage de la biodiversité. Il y a également de nombreux partenaires qui viennent étayer ce projet, et qui unissent leurs forces afin d’explorer la biodiversité marine que l’on connaît encore mal.
Comment vous y prenez-vous pour construire cet Atlas ?
Le projet ATLASea s’articule en trois chevrons :
![]()
Nous nous concentrons exclusivement sur la biodiversité française, en échantillonnant tout au long de la Zone Économique Exclusive (ZEE). La carte ci-dessus montre l’étendue des données dont nous disposons actuellement. La majorité de ces données est concentrée le long des côtes, avec quelques radiales correspondant aux campagnes récurrentes de l’Ifremer pour évaluer les stocks halieutiques. En effet, pour le projet ATLASea nous nous appuyons sur des moyens à la mer existants, c’est-à-dire ceux des stations marines ainsi que ceux mobilisés par les campagnes Ifremer. Notre échantillonnage est structuré par l’exploration de divers gradients, tels que les zones de transition terre-mer ou encore les différents niveaux de préservation.
En métropole, nous prévoyons de séquencer 3 900 génomes, auxquels s’ajouteront 600 génomes issus des zones ultramarines. L’année dernière, nous avons déjà mené une campagne d’échantillonnage en Nouvelle-Calédonie, et je me prépare à partir pour les îles périphériques de la Guadeloupe. D’autres campagnes sont également prévues, notamment à Saint-Paul et Amsterdam, en Polynésie, à Mayotte… Autant de territoires fascinants que nous avons à cœur d’étudier.
Vous dites séquencer 4 500 espèces, est-ce que c’est beaucoup, ou en tous cas suffisant pour représenter la biodiversité marine ?
Effectivement, la question mérite d’être posée ! Le long des côtes métropolitaines, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) répertorie 13 600 espèces, dont plus des trois quarts sont des animaux. Le quart restant se compose de plantes (comme la posidonie de Méditerranée ou les algues vertes et rouges), de chromistes, de champignons, et de quelques unicellulaires. Nous souhaitons explorer chacune de ces lignées pour produire des génomes.
Le saviez-vous ?
La biodiversité animale recouvre une grande diversité de groupes taxonomiques. Chez les organismes marins, les arthropodes sont le groupe le plus représenté, suivis par les mollusques, les annélides, et enfin les chordés, qui incluent les poissons. Lorsque l’on évoque la “biodiversité marine”, on pense souvent aux poissons, mais en réalité, il faudrait d’abord penser aux crevettes, aux vers et aux mollusques !
La vie est apparue dans les océans, et de nombreuses lignées ne se trouvent que dans le milieu marin. D’un point de vue phylogénétique, il est donc extrêmement intéressant pour nous de pouvoir produire des génomes pour chacun de ces grands groupes.
En définitive, nous travaillons, bien sûr, sur les groupes taxonomiques les plus représentés, mais nous veillons également à échantillonner au sein de chaque groupe pour refléter au mieux la diversité du vivant.
Concrètement, comment se passe la récolte de données sur le terrain ?
Nous allons chercher les organismes sous l’eau soit en plongée soit à l’aide d’engins tels que des dragues de 80 cm, puis nous les ramenons à terre où nous avons mis en place une chaîne de tri. Les échantillons ramenés sont fractionnés par classe de taille à l’aide d’une série de tamis. Chaque fraction de taille est triée par grand phylum puis les taxonomistes identifient les spécimens le plus finement possible. Ensuite chaque spécimen vivant est photographié, afin de conserver une information sur ses couleurs avant d’être conservé dans l’alcool qui les fait disparaître. Nous nous attachons donc à documenter toutes ces étapes.
Pourriez-vous nous donner un exemple de toute cette chaîne de procédés, de la capture sur le terrain jusqu’à la mise en ligne du génome ?
Bien sûr ! Je vous invite à me suivre à travers le parcours de la praire Venus verrucosa, un mollusque bivalve, et première espèce intégrée dans le projet ATLASea.

Source : Dominique Horst
En avril 2022, ce spécimen a été récolté sur le terrain, à la station marine de Roscoff. Après la récolte, une phase d’identification a eu lieu avec le soutien de notre réseau de taxonomistes (pour la praire, cette étape n’était pas trop complexe). Ensuite est venu le séquençage du génome. Comme le séquençage est une initiative internationale, nous devons d’abord vérifier que la praire n’est pas déjà en cours de séquençage dans un autre projet. Il s’est avéré qu’elle faisait partie des espèces d’intérêt pour le projet Darwin Tree of Life, mais comme nous avons été les premiers à la collecter, nous avons pu lancer notre propre séquençage.
Les spécimens ont été photographiés, puis le Génoscope a pris le relais. Les tissus ont été prélevés avec soin pour éviter toute contamination, puis l’ADN a été conservé à l’aide de la technique de congélation rapide (“flash freezing”). Cette méthode, qui consiste à plonger le spécimen dans de l’azote liquide et à le conserver à -80°C permet d’éviter la dégradation de l’ADN. Les tissus de cette praire ont ensuite été analysés avec différentes techniques de séquençage en parallèle pour établir son génome de référence. L’objectif est d’obtenir la carte chromosomique complète de chaque séquence, en utilisant la technique HiC, ainsi qu’une grande profondeur de séquençage pour garantir la précision des données. Pour annoter les génomes et comprendre la fonction des gènes, la méthode la plus efficace est d’extraire et séquencer l’ARN. Au total, au moins quatre séquençages différents sont réalisés en parallèle pour chaque spécimen.
Et voilà, notre praire est désormais le premier génome entièrement séquencé du projet ATLASea ! Elle est désormais répertoriée sur un tableau de bord public (ici !), où l’on peut retrouver le génome obtenu, ainsi que visualiser une carte de distribution de l’espèce, semblable à celles produites par le GBIF (Global Biodiversity Information Facility, soit le Système mondial d’information sur la biodiversité).
Ok j’ai compris, séquencez-les tous ! C’est bien beau, mais les séquencer pour quoi faire ?
Ce projet nous permet de plonger au cœur de la taxonomie, un enjeu majeur pour la recherche. Aujourd’hui, environ 250 000 espèces ont été découvertes dans le milieu marin, et chaque année, en moyenne, 2 700 nouvelles espèces s’ajoutent à cette liste. On estime que la biodiversité marine encore inconnue est aussi vaste que celle des milieux terrestres. Ainsi, on évalue qu’il reste environ 80 % de la biodiversité marine à découvrir.
Au-delà de l’intérêt taxonomique, cette vaste banque de données génomiques que nous construisons peut avoir de multiples applications, comme en phylogénomique ou encore en génomique comparative. Dans le cadre des PEPR, l’ANR va lancer des appels à projets thématiques que nous avons choisi d’articuler autour de deux axes :
Tant de possibilités intéressantes en perspective !
Face à cette urgence, un constat s’impose : il est impératif de protéger la biodiversité marine. Dans ce contexte, la création d’aires marines protégées (AMP) est devenue une priorité mondiale. Toutefois, leur efficacité à protéger durablement la biodiversité reste une question complexe, soulevant des interrogations sur leur mise en place, leurs statuts et leurs impacts réels. Embarquons ensemble pour un périple au fil de l’eau, à travers des articles scientifiques publiés récemment et issus, pour la plupart, de travaux permis par la FRB à travers son Cesab.
2025 s’annonce comme l’année de l’Océan en France avec comme point d’orgue l’organisation à Nice de la troisième conférence des Nations Unies pour l’océan. Un article paru ce vendredi dans la revue OneEarth illustre l’ampleur des défis, les scénarios possibles et les opportunités liées à la coexistence entre populations humaines et poissons récifaux. Le choix de ces poissons en particulier n’est pas un hasard : les récifs tropicaux peu profonds couvrent moins de 1 % des océans mais abritent environ un tiers de la biodiversité marine mondiale et apportent une contribution culturelle et alimentaire essentielle à plus d’un milliard de personnes. Emblématiques, ils sont néanmoins particulièrement affectés par les activités humaines. Le travail mené par un consortium international ouvre des pistes originales et propose une méthodologie qui pourrait aussi être appliquée aux écosystèmes terrestres. Il souligne l’importance des politiques de restauration de la nature dont les bénéfices sont multiples et synergiques : restaurer les populations, les communautés d’espèces, les fonctions écologiques, bénéficie à la fois à la biodiversité et aux humains.
Les facteurs socio-économiques ayant plus d’influence que les facteurs environnementaux dans la mise en place des aires protégées, identifier les zones favorables et défavorables à l’implémentation de nouvelles aires protégées en tenant compte de ces critères permettra une stratégie de conservation plus réaliste et efficace.
Pour obtenir ces cartes d’opportunités et de contraintes locales en conservation, le groupe de chercheurs comprenant des scientifiques de l’Université de Montpellier, de l’EPHE-PLS, du CNRS et du CEA a divisé la surface du globe en près d’un million de cellules de 10 x 10 km. Pour chacune de ces cellules ils ont obtenu des données relatives à des facteurs environnementaux mais aussi socio-économiques, en se basant sur plus de 18 bases de données mondiales différentes. Ces données ont servi à construire un modèle prédictif qui estime la probabilité qu’une zone du globe soit protégée en fonction des différents facteurs étudiés, qu’ils soient environnementaux (température, altitude, précipitations par exemple) ou socio-économiques (PIB, indice de développement humain, présence d’ONG locales etc.).
Même sans information sur la biodiversité d’une zone, il est possible d’inférer de manière très fiable la probabilité de présence d’une aire protégée en n’utilisant qu’un petit groupe de facteurs socio-environnementaux. Les facteurs socio-économiques montrent même une plus grande importance que les facteurs environnementaux dans ces modèles prédisant la mise en place de futures aires protégées. Par exemple l’indice de développement humain et le nombre d’ONG favorisent la présence d’aires protégées terrestres alors qu’en mer l’accessibilité et la dépendance aux stocks de poissons sont les principaux obstacles de blocage à la mise en place de nouvelles aires marines protégées.
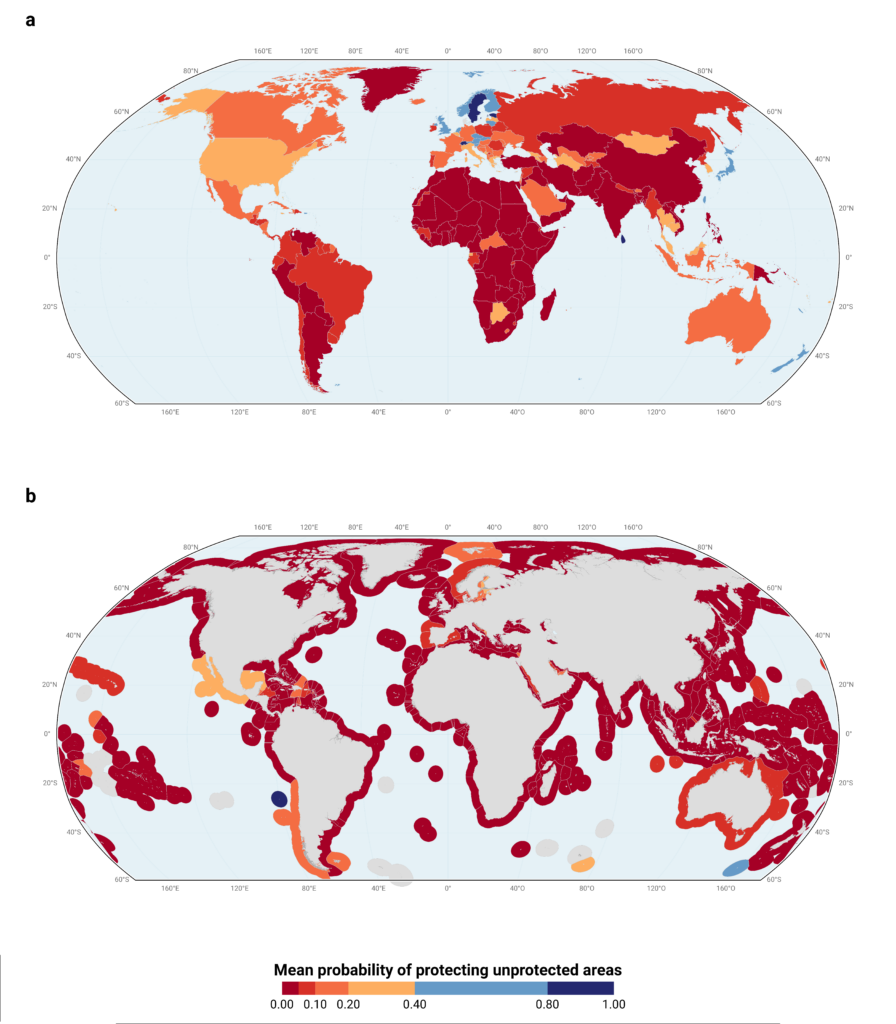
Ce modèle a ensuite été utilisé pour cartographier les zones où les besoins en conservation des vertébrés (poissons, mammifères et oiseaux) sont les plus urgents mais aussi celles où les facteurs socio-économiques limiteraient ou favoriseraient la mise en place d’une aire protégée.
Pour aller + loin
Quid du devenir des zones de conservation prioritaires mais qui cumulent également les critères socio-économiques défavorable au statut d’aires protégées ? Bien souvent, les enjeux sociaux-économiques et les besoins des populations locales sont indissociables de la mise en place d’aires protégées. Ainsi, en Afrique et en Asie, certaines zones à haute valeur de conservation restent impossibles à protéger, face aux enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles. Implémenter les facteurs socio-économiques s’avère donc primordial pour optimiser la mise en place des zones de protection, dont les décisions actuelles se concentrent majoritairement sur les facteurs environnementaux qui influencent la biodiversité. Encore une preuve qu’assurer des conditions sociales et économiques minimales est un prérequis pour la mise en place de stratégies de conservation efficaces et durables.
Aux acteurs et décideurs politiques maintenant de prendre pleinement la mesure des actions nécessaires pour parvenir à l’objectif de 30% d’aires protégées d’ici à 2030.
Cette étude est le fruit d’un travail collaboratif animé par la FRB et son Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) au sein des groupes Pelagic et Parsec. Ce travail a été permis grâce aux financements de la ZSL, du WWF, de l’Université de Montpellier et aux Cesabbatic de Jessica Meeuwig et Tom Letessier.
La Journée FRB 2024 a rassemblé des experts scientifiques, des décideurs et des acteurs de la société civile pour partager leurs connaissances et proposer des solutions face aux défis de la conservation de l’océan. Organisée en partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, et l’Ifremer, cet événement s’est articulé autour du Nature Futures Framework (NFF), le cadre de scénarios futurs pour la nature, un concept de l’Ipbes. La Journée a été rythmée par les trois perspectives de ce NFF : la nature pour la nature, la nature comme culture et la nature pour la société. L’objectif ? Parvenir collectivement à un avenir plus soutenable pour l’océan.
Souvent étudiés au niveau des espèces, les changements induits par les activités humaines et le changement climatique le sont bien plus rarement au niveau des communautés écologiques (ensemble des espèces peuplant un écosystème donné). Dans cet article, les auteurs et autrices ont évalué une grande quantité de données sur une vaste zone d’étude (8 écorégions dans le plateau continental Européen), une période temporelle étendue (1994 à 2019) et une large gamme d’espèces (513). L’accent mis sur les caractéristiques morphologiques, physiologiques, phénologiques ou comportementales des espèces (les traits fonctionnels), plutôt que sur leur identité se révèle plus pertinent pour comprendre comment les communautés sont façonnées par leur environnement.
Les résultats confirment qu’en surface, les facteurs influençant les communautés de poissons sont la température, la salinité et la chlorophylle-a et la structure verticale de la colonne d’eau, tandis qu’au fond, les facteurs influençant les communautés de poissons sont la température et l’oxygène. Par ailleurs, les auteurs démontrent que dans les régions qui se réchauffent plus rapidement (la Méditerranée par exemple) les communautés de poissons contiennent des espèces avec une maturité sexuelle plus précoce, des temps de génération courts et la production de larves petites et pélagiques avec des taux de dispersion élevés. Dans les régions qui se réchauffent moins vite les communautés de poissons accueillent plus d’espèces à maturité sexuelle tardive et de niveau trophique élevé. Ces résultats permettent de mieux comprendre, par exemple, pourquoi des poissons comme la plie augmentent dans l’Atlantique Nord-est, alors que le merlu augmente en Méditerranée.
Les approches générales comme celle-ci sont essentielles afin d’obtenir une vision globale de l’effet des perturbations sur les communautés de poissons : elles montrent qu’il est important de mesurer et de comprendre l’abondance et la composition des assemblages d’espèces locales, en plus de la présence-absence des espèces, pour améliorer la compréhension de la résilience climatique écologique des communautés de poissons et identifier des stratégies de gestion adaptative.
> Retrouvez l’article : Receveur, A., Leprieur, F., Ellingsen, K. E., Keith, D., Kleisner, K. M., McLean, M., Mérigot, B., Mills, K. E., Mouillot, D., Rufino, M., Trindade-Santos, I., Hoey, G. V., Albouy, C., & Auber, A. Long-term changes in taxonomic and functional composition of European marine fish communities. Ecography (2024).
https://doi.org/10.1007/s10531-023-02660-5
Entre pressions directes et facteurs indirects qui les aggravent, les scientifiques ont déjà mis en évidence les points de leviers pour envisager un avenir plus soutenable pour nos océans. Toutefois, mettre en œuvre les changements transformateurs nécessaires n’est pas trivial.
En partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier – Prince de Monaco et l’Ifremer, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) propose, à travers sa Journée annuelle, d’explorer comment le cadre des scénarios futurs pour la nature, le Nature Futures Framework (NFF), peut permettre de mieux appréhender tous les enjeux de l’océan, avec une vision intégrative des relations nature-humains sous un angle nouveau, plus systémique.
Le Cadre pour l’avenir de la nature est un outil flexible qui vise à promouvoir l’élaboration de scénarios centrés sur la nature, et qui tiennent compte de la diversité des valeurs de la biodiversité, afin d’éclairer les options politiques.
Le NFF se concentre sur trois grandes perspectives en termes de valeurs et de conceptions du monde :
Les usagers de l’océan considèrent la valeur intrinsèque des écosystèmes, leur intégrité, la diversité des espèces, des habitats et des processus associés.
Elle insiste sur les valeurs relationnelles de la nature, imbriquant sociétés, cultures, traditions et croyances et façonnant divers paysages bioculturels.
L’accent est mis sur la modernité littorale, insulaire, technologique, les avantages utilitaires et les valeurs instrumentales que la nature et ses ressources fournissent aux acteurs économiques et aux sociétés.
L’océan est un milieu tridimensionnel comportant une importante dimension verticale, la profondeur, qui structure des écosystèmes uniques et des usages humains spécifiques. Cependant, les outils de gestion et de conservation marine sont dominés par une représentation bidimensionnelle de l’océan, qui néglige cette stratification verticale. Si cette représentation réductionniste de l’océan était compatible avec des usages humains principalement côtiers, l’expansion de l’empreinte humaine vers la haute mer et l’océan profond nécessite une nouvelle approche prenant en compte cette complexité verticale. La prise en compte de la profondeur de l’océan est particulièrement importante étant donné les nouveaux objectifs des accords de Montréal-Kunming, notamment celui d’atteindre 30 % de couverture de protection marine d’ici 2030, ainsi que le récent traité international pour la gestion de la biodiversité en haute mer.
Dans ce contexte, des chercheurs du Criobe et de l’Université de Washington ont développé une nouvelle approche pour évaluer la distribution des impacts humains et des efforts de conservation à travers les trois dimensions de l’océan : latitude, longitude et profondeur. Pour ce faire, une typologie des principales unités écologiques à travers les profondeurs (Figure 1) est surimposée à une typologie bidimensionnelle des écorégions marines pour définir des écorégions tridimensionnelles.
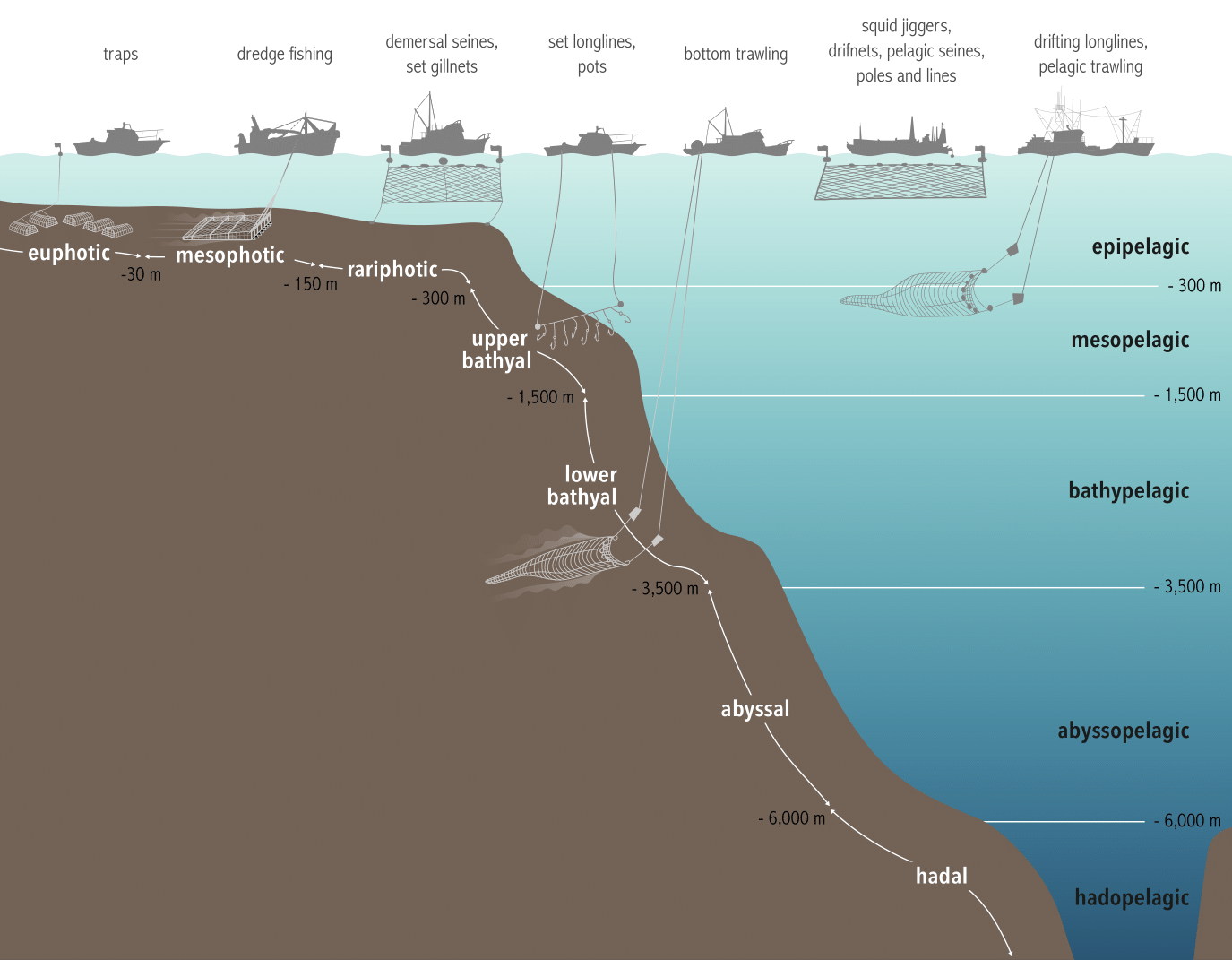
Figure 1 : Profondeur atteinte par les activités de pèche par type d’engins. La profondeur des pictogrammes représentant chaque engin indique la profondeur maximale où ces engins opèrent.
À l’aide de cette nouvelle typologie, l’équipe a évalué la distribution tridimensionnelle mondiale des efforts de conservation et des activités de pêche, qui constituent aujourd’hui la principale pression humaine directe sur les écosystèmes marins. Les analyses s’appuient sur des bases de données publiques, telles que le Global Fishing Watch pour les activités de pêche, le World Database on Protected Area pour les efforts de conservation et le GEBCO pour les données bathymétriques.
Les résultats ont révélé que les différentes profondeurs de l’océan, qui correspondent à des écosystèmes uniques, bénéficient d’efforts de conservation très disparates. Alors que les écosystèmes les moins profonds (0 à 30 m) sont les mieux protégés, les écosystèmes plus profonds, notamment le mésophotique (30 à 150 m), le rariphotique (150 à 300 m) et les abysses (3500 à 6000 m), n’ont toujours par atteint l’objectif de 10 % de couverture de protection fixé par la Convention sur la diversité biologique (CDB) et qui aurait dû être atteint depuis 2020. Par contraste, l’empreinte 3D des activités de pêche s’étend à travers toutes les profondeurs, avec notamment 37 % des activités mondiales de pêche opérant dans l’océan profond, en-dessous de 300 m.
D’autre part, les résultats démontrent que les efforts de conservation sont disproportionnellement dirigés vers les aires où le moins d’activité de pêche ont lieu, un phénomène d’évitement dénommée ” conservation résiduelle “. Autrement dit, les aires les plus impactées par les pressions humaines demeurent le plus souvent sans protection. De plus, les aires marines de protection forte, où les régulations d’extraction sont strictes, et qui fournissent les bénéfices écologiques les plus importants, sont sous-représentées dans toutes les écorégions et à toutes les profondeurs, avec seulement 1,4 % de couverture à l’échelle mondiale.
Les faiblesses du réseau mondial d’aires marines protégées soulignées par cette étude appellent à une représentation plus holistique de l’océan, prenant en compte sa structure verticale et les processus complexes de connectivité reliant le pélagique au benthique. Améliorer la représentation écologique à toutes les profondeurs, augmenter la couverture de protection forte, et prioriser les zones les plus impactées par les usages humains doivent constituer la priorité des stratégies de conservation à l’échelle nationale et mondiale.
En raison de leurs contrats à durée déterminée (les fameux “postdocs”) et du recrutement tardif sur des postes permanents, ils sont soumis à une forte pression pour publier leurs travaux de recherche car cela contribue à la construction de leur réputation et facilite leur avancement académique et professionnel. Publier dans des revues à fort impact – c’est-à-dire avoir une publication académique acceptée dans un journal jouissant d’une grande visibilité et influence au sein de la communauté scientifique – est essentiel pour s’assurer une future carrière. Consciente des enjeux éthiques liés aux coûts exorbitants des publications et à l’utilisation de ces fonds, émanant principalement de fonds publics, cette génération se retrouve confrontée à un défi de taille : comment combiner évolution de carrière et posture éthique?
Dans une majorité de cas, une fois leur article accepté par la rédaction d’un journal scientifique, les chercheuses et chercheurs doivent payer pour en permettre la publication (cessation des droits d’auteurs au journal, frais de publication, etc.). Dans cet article d’opinion, les jeunes scientifiques du Cesab dénoncent le fait que certains journaux utilisent les marges financières pour rétribuer les actionnaires de ces journaux. Ils plaident pour que le système de publication soit à but non lucratif, c’est-à-dire que les frais de publication servent à payer les frais de publications sans en tirer de profit pour des actionnaires, et qu’ils retournent dans le système académique, par exemple en organisant des conférences.
Ces dernières années, les initiatives et alertes des scientifiques sur cette problématique se sont multipliées, prenant des formes diverses, avec des grèves au sein des rédactions, ou encore à travers une politique de choix restreint et engagés des revues où soumettre des articles scientifiques, etc. Au-delà des gestes individuels comme le boycott de ces journaux non-éthiques, ce qui est risqué pour de jeunes scientifiques, des actions sont possibles pour faire évoluer les pratiques et mentalités des chercheurs et chercheuses tout au long de leur carrière et dans les différents aspects de leur vie académique – au cours de l’écriture d’article, de l’évaluation et de l’édition, membres de comités d’évaluation et collègues.
Dans le domaine de l’écologie et de l’évolution, les autrices et auteurs proposent les alternatives suivantes :
Alors que la communauté académique semble de plus en plus consciente du problème éthique majeur lié au système actuel d’édition scientifique, il est désormais nécessaire de passer à l’action pour des changements systémiques majeurs. Déployés collectivement, ces efforts peuvent permettre à la communauté scientifique, et en particulier aux jeunes chercheuses et chercheurs, de sortir de ce conflit entre éthique et carrières.
Accéder à l'article d'opinion (ENG)
Dans une publication parue jeudi dernier dans le journal Science, Tom B Letessier, chercheur à la Société zoologique de Londres (ZSL), et ses collègues livrent les résultats d’une étude impressionnante sur la taille corporelle des poissons. Des données collectées pendant 14 ans ont été analysées, représentant environ 20 000 heures de vidéos sous-marines filmant près d’un million d’individus de 1460 espèces différentes. Un travail d’analyse complexe et de longue haleine mené en France au de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité, le Cesab, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).
Recueillies grâce à des pièges caméras, ces données ont permis de comparer l’efficacité des zones protégées chez les populations de poissons pélagiques (vivant au-dessus du plancher marin comme les thons, sardines ou encore requins soyeux) et chez les populations de poissons benthiques (vivant sur le plancher marin tels que les raies, limandes ou labres). En effet, en mer, la taille des poissons donne de vraies indications sur leur place dans la chaîne alimentaire, et donc sur le fonctionnement de l’écosystème étudié.
“Pour les populations pélagiques, l’effet des aires marines protégées (AMP) se conjugue avec leur distance de la côte : plus une AMP est éloignée de la côte, plus elle apparaît efficace pour protéger les poissons pélagiques. Ce résultat contraste avec les populations benthiques, pour lesquelles les AMP les plus efficaces se trouvent proches des côtes, et des activités humaines.”
Tom B Letessier
Cette étude rappelle la nécessité de répartir des aires marines protégées entre zones côtières et haute mer afin de permettre aux populations pélagiques, déjà surexploitées, de se restaurer, loin des activités humaines.
Aller + loin : Aires marinées protégées et taille des poissons, un sujet scientifique d’actualité
Pourquoi les poissons des zones benthiques et pélagiques ont-elles des réponses différentes aux activités humaines et à leur proximité ? Les raisons écologiques de ce phénomène sont encore mal connues. Une des hypothèses serait l’absence de « refuge » dans les zones pélagiques, alors que les zones benthiques, du fond de l’océan, offrent une protection aux individus les plus petits ou les plus jeunes, qui peuvent se cacher dans les algues.
D’autres travaux soulignent la complexité des phénomènes écologiques impliqués. Une publication de Chen et al. parue dans PNAS en novembre 2023 montre qu’une augmentation de la survie des individus adultes en zone protégée peut avoir de nombreux effets en cascade et qui varient dans le temps : augmentation de leur taux de reproduction, de leurs densités et donc de leur compétition pour la nourriture, ce qui peut les inciter à sortir de ces zones plus tôt dans leur vie, selon la taille des aires protégées.
L’emplacement et la taille des aires marines protégées sont donc des facteurs fondamentaux à prendre en compte pour protéger au mieux la biodiversité marine.
La décennie des Nations unies (NU) pour les sciences océaniques et la conférence des NU sur l’océan qui se tiendra à Nice en juin 2025 s’annoncent décisives pour l’avenir de l’océan. Il y a en effet urgence. À lui seul, l’océan recouvre plus de 70 % de la surface de la planète et représente plus de 90 % du volume habitable pour le monde vivant. Des milliards de personnes à travers le monde dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins (ressources alimentaires, culture, etc.). Pourtant, la plupart des activités humaines ont un impact majeur sur l’océan.
Entre pressions directes et facteurs indirects qui les aggravent, les scientifiques ont déjà mis en évidence les points de leviers pour envisager un avenir plus soutenable pour nos océans. Toutefois, mettre en œuvre les changements transformateurs nécessaires n’est pas trivial.
En partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier – Prince de Monaco et l’Ifremer, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) propose, à travers sa Journée annuelle, d’explorer comment le cadre des scénarios futurs pour la nature, le Nature Futures Framework (NFF), peut permettre de mieux appréhender tous les enjeux de l’océan, avec une vision intégrative des relations nature-humains sous un angle nouveau, plus systémique.
Rendez-vous le 29 mai prochain, à la Maison de l’Océan (Paris Ve).
Événement sur inscription, accessible en présentiel et en distanciel
Comment est arrivée la crépidule sur les côtes françaises ?
La crépidule est arrivée par différents biais, mais majoritairement avec le commerce de l’huitre creuse. En important ces huitres, on a importé avec elles tout un cortège d’espèces exotiques qui étaient à l’état larvaire ou juvénile, cachées dans leurs coquilles. L’établissement de la crépidule date des années 70. Mais elle devient vraiment envahissante dans les années 80 et 90. On la retrouve sur tout le littoral français, notamment dans la rade de Brest.
Quand la crépidule s’est multipliée quels impacts notables a-t-elle eu sur l’écosystème ?
La crépidule est un gastéropode qui a besoin d’un substrat dur et lisse pour se fixer, un rocher plat ou un débris de verre par exemple. Au début de son introduction, elle en a eu besoin mais comme elle s’est mise à proliférer, elle s’est étendue sur des fonds qui étaient meubles et s’est auto-entretenue du fait que les jeunes individus se fixent préférentiellement sur les chaines d’adultes, empilés les uns sur les autres. Elle a ensuite servi de support à des espèces qui aiment les substrats durs comme les ascidies, les éponges et certains bivalves comme le pétoncle noir, lequel est par ailleurs une espèce actuellement en déclin.
Outre le fait de servir d’habitat à d’autres espèces, la crépidule a-t-elle eu d’autres effets positifs ?
Les crépidules sont des organismes filtreurs qui se nourrissent en filtrant l’eau pour capturer des particules de nourriture, notamment des micro-algues. En filtrant activement l’eau, elles peuvent contribuer à réduire la turbidité, limitant ainsi les efflorescences de certaines espèces du phytoplancton, en particulier des dinoflagellés.
Inversement, en quoi la crépidule a déstabilisé les écosystèmes ?
Pour arriver à déstabiliser un écosystème entier, il faut dépasser un certain seuil en termes de densité ou de biomasse. C’est ce qu’il s’est passé dans certaines zones où sur un mètre carré, il a pu y avoir plusieurs milliers d’individus. Or, la crépidule est un animal filtreur qui, pour se nourrir et s’oxygéner, filtre une grande quantité d’eau de mer et produit beaucoup de fèces : dans ces conditions, elle a déstabilisé l’écosystème avec un envasement des fonds, y compris les fonds sableux qui sont devenus des fonds vaseux. Plusieurs espèces de fonds sableux comme la coquille Saint Jacques ou les juvéniles de soles ont donc reculé.
Il semblerait qu’après avoir prospéré sur nos côtes ses populations diminuent.
Depuis le milieu des années 2000, on constate effectivement un recul de la crépidule. En rade de Brest des investigations menées entre 2013 et 2018, des prélèvements sur le terrain et des vidéos sous-marines ont permis de démontrer clairement que le stock avait très significativement diminué en particulier dans tout le bassin sud de la rade. Elle semble néanmoins s’être maintenue dans le secteur nord de la rade. Si on ne sait pas exactement pourquoi elle recule, on a suspecté néanmoins des polluants arrivés du bassin versant du sud de la rade pour expliquer son déclin. Mais souvent, un déclin est multifactoriel et prend du temps.
Le fait que la crépidule décline en fait-elle une exception parmi les espèces exotiques envahissantes ?
Il semblerait que d’autres espèces comme la caulerpe (Caulerpa taxifolia) en méditerranée, considérée elle aussi comme envahissante, décline naturellement. Il y a plusieurs pistes d’investigation pour chercher à comprendre pourquoi. Il y a comme un cycle qui s’observe, où au bout de 20-30 ans, on voit des espèces proliférantes décliner. Sans doute parce que petit à petit d’autres interactions avec d’autres espèces s’opèrent. Elles sont alors contrôlées soit par des parasites soit par des prédateurs qui permettent à ces espèces exotiques envahissantes de trouver une place régulée dans l’écosystème.
Est-ce une loi ?
Non, car en milieu marin ou terrestre, il y a plusieurs exemples d’espèces proliférantes qui ont fait basculer irréversiblement l’écosystème dans un état différent. Par exemple des oursins, qui sont des herbivores, peuvent dévorer intégralement d’immenses champs d’algues qui laissent place à des fonds complètement nus. C’est vrai aussi dans des milieux tropicaux où des étoiles de mer ont décimé des récifs de coraux. Donc parfois, passé ce « point de bascule », on assiste à l’établissement d’un tout autre écosystème.
Quel est l’état aujourd’hui de la rade de Brest ?
La rade n’a pas retrouvé son état écologique d’avant l’arrivée de la crépidule. Il reste toujours des traces à commencer par les amas de coquilles de crépidules mortes dans la partie sud. Certes, elles servent encore de support à certaines espèces, mais la biodiversité y est beaucoup moins luxuriante que lorsque l’on avait des bancs de crépidules vivantes. La rade est par ailleurs impactée par diverses pollutions et par des activités humaines, comme la pêche aux engins trainants qui dégradent les habitats et remettent en suspension des particules. L’écosystème évolue sans cesse, s’adapte parfois, et il reste heureusement des zones dans cette rade où les écosystèmes fonctionnent toujours bien.
En quoi consiste la prévention ?
Elle vise à mettre en place des mesures de contrôle des importations aux frontières et de biosécurité pour limiter l’arrivée de nouvelle espèces exotiques et leur déplacement. Cela nécessite un cadre réglementaire et une surveillance biologique organisée du territoire. La surveillance doit se concentrer sur les points chauds d’introduction tels que les ports et les aéroports, les voies de communication, comme les routes ou les voies ferrées, qui constituent des corridors de dispersion. Une vigilance particulière doit aussi être portée aux espaces prioritaires, tels que les espaces naturels et les aires protégées abritant des espèces patrimoniales, endémiques ou en danger qui pourraient être menacées par ces espèces exotiques envahissantes.
Combien d’espèces arrivent sur le territoire ?
D’après l’indicateur de l’observatoire national de la biodiversité, depuis 1983, un département de métropole compte en moyenne 11 espèces exotiques envahissantes de plus tous les dix ans. Le cas du frelon asiatique est emblématique. Détecté pour la première fois en 2004 en France, il a depuis colonisé presque toute l’Europe. Le coût de la lutte contre cette invasion en France se chiffre à plusieurs millions d’euros par an, et s’accroit avec le temps. L’éradication aurait été possible au début de l’installation de l’espèce. Aujourd’hui ce n’est plus envisageable, on est obligé de vivre avec.
Y a-t-il régulièrement des alertes ?
La pression aux frontières est permanente. Il y a déjà eu plusieurs alertes nationales d’invasions biologiques potentielles. Entre 2019 et 2021, quatre nouvelles espèces exotiques d’écrevisses problématiques pour nos cours d’eau ont été découvertes en France. Originaires d’Amérique du Nord, elles ont sans doute été introduites accidentellement, mais on ne peut pas exclure des relâcher intentionnels. En 2022, la petite fourmi de feu ou fourmi électrique a été découverte à Toulon. Cette espèce originaire d’Amérique du Sud est l’une des cinq espèces de fourmis les plus envahissantes au monde. On peut supposer qu’elle est arrivée par des bateaux militaires ou par le commerce des plantes. Bien que nous parvenions à les identifier et les détecter, il y a encore peu de réponses efficaces face à ce problème.
Lorsque l’espèce exotique envahissante est déjà installée sur le territoire comment limite-t-on son déplacement ?
Il existe des listes réglementaires et scientifiques. La liste règlementaire permet par exemple d’interdire l’importation ou la commercialisation des espèces identifiées. Pour la France métropolitaine, 94 espèces sont aujourd’hui réglementées et interdites de commerce, transport ou encore colportage. Mais on est bien loin du nombre des espèces pouvant s’installer sur le territoire. A côté de cela, il existe des listes scientifiques qui se fondent sur des inventaires, des évaluations et la caractérisation du risque. Bien que parfois soumises à discussion et débat sur la méthodologie, ces listes permettent d’orienter des actions de surveillance et de gestion sur le territoire.
Qui est en charge de construire ces listes scientifiques ?
Pour la flore, se sont notamment les conservatoires botaniques nationaux qui sont en charge de produire ces listes. Aujourd’hui, on arrive à inventorier entre 600 et 900 plantes naturalisées dans chaque région. Une centaine sont considérées comme espèce exotique envahissante. Mais ce statut peut varier avec l’espace et le temps. Une espèce peut être considérée comme envahissante dans le sud par exemple, mais pas dans le nord. Elle peut l’être ou le devenir puis disparaitre. C’est par exemple le cas de la Caulerpe (Caulerpa taxifolia) qui a envahi les côtes de plusieurs pays méditerranéens dans les années 1990-2010, mais dont les populations sont aujourd’hui en forte régression. Des espèces exotiques problématiques sur le moment peuvent , après de nombreuses années, trouver leur place dans l’écosystème et fournir par exemple des services écosystémiques qui avaient disparus. Les acteurs confrontés aux invasions biologiques s’interrogent de plus en plus sur les évolutions possibles vers des « néo-écosystèmes », définis comme des assemblages hybrides et fonctionnels d’espèce indigènes et d’espèces exotiques. C’est un sujet émergent pour la recherche.
Les politiques publiques nationales sont-elles cohérentes pour répondre à cet enjeu ?
Pas toujours… Par exemple, dans un contexte de changement climatique, un enjeu majeur pour la forêt française est d’accroître ses capacités de résilience pour garantir la qualité et la quantité de l’ensemble des services fournis. Parmi les solutions proposées, le recours à des essences exotiques au sein « d’îlots d’avenir », plus tolérants à la chaleur et à la sécheresse, est encouragé par les pouvoirs publics. Or une part importante des espèces préconisées sont des espèces exotiques comme le robinier, le chêne rouge ou le noyer noir dont le caractère envahissant pour certaines est bien documenté en France et ailleurs dans le monde. A l’heure où les scientifiques n’ont de cesse d’alerter sur les impacts négatifs des invasions biologiques, la question de la cohérence entre nos politiques publiques nationales se pose d’autant plus.
Avons-nous en France les moyens de prévenir les invasions biologiques ?
Depuis quelques années, des réseaux et des groupes de travail se sont constitués et des stratégies régionales en métropole et en outre-mer ont été élaborées pour définir un cadre d’action collectif. Les résultats sont là en termes d’amélioration des connaissances, de stratégie collective, de réglementation. On sait ce qu’il faut faire. Reste la question des moyens humains, financiers et d’une volonté politique pour mettre en œuvre la prévention. Il nous faut aujourd’hui accentuer la sensibilisation des citoyens, des élus et professionnels, renforcer notre biosécurité avec plus de personnels formés aux frontières et sur le terrain et une surveillance biologique coordonnée du territoire. Enfin, il nous faut soutenir davantage la recherche pour développer des outils d’aide à la décision afin de mieux anticiper les prochaines invasions.
L’activité anthropique a considérablement modifié la structure et le fonctionnement de tous les écosystèmes de la planète notamment en mer et sur littoral. Néanmoins, des solutions existent pour faire face à ces impacts. S’appuyant sur les résultats de la recherche, l’Ipbes a identifié cinq pressions directes sur la biodiversité ayant les incidences les plus lourdes à l’échelle mondiale. Il s’agit de la modification de l’utilisation des terres et des mers, de la surexploitation des ressources sur terre comme en mer, des changements climatiques, qui affectent tous les compartiments de l’environnement, des pollutions et des espèces exotiques envahissantes, qui perturbent les équilibres, notamment aux échelles locales.
Cette étude se focalise sur la réduction des principales pressions directes exercées sur la biodiversité pour renforcer l’efficacité des mesures proposées dans le cadre des documents stratégiques de façade qui définissent les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral. Pour ce faire, la FRB a effectué une extraction des solutions à partir d’articles de recherche récents afin de fournir une perspective récente sur des priorités pour trois principales pressions directes s’exerçant sur la biodiversité.
Les trois pressions directes présentées dans ce dossier sont la modification de l’utilisation des mers, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Les résultats de cette analyse ont été regroupés par pression et sont disponibles à travers trois fiches thématiques.
On assiste à une augmentation des activités offshore telles que la production d’énergie, l’aquaculture, le tourisme, le développement des biotechnologies et l’exploitation minière (Stuiver et al., 2016) ou encore l’installation de plateformes multi-usages (MUPs). Ces activités font des mers européennes le théâtre d’une croissance massive des infrastructures maritimes et d’une compétition spatiale (Stuiver et al., 2016).
Parmi les activités offshores, la pisciculture en cages flottantes pose la question, à l’échelle européenne, des évasions (Arechavala-Lopez et al., 2018) qui recouvrent l’échappée de poissons isolés, de groupes de poissons (de quelques-uns au million), d’œufs viables et fécondés (Arechavala-Lopez et al., 2018). Elles se produisent en raison de défaillances techniques et opérationnelles (Arechavala-Lopez et al., 2018) :
Le développement des énergies marines renouvelables (EMR) est également notable. Celles-ci peuvent fournir jusqu’à 7 % de la demande mondiale en électricité : la plupart via l’éolien offshore, l’énergie marémotrice pourrait répondre, quant à elle, à environ 0,75 % de cette demande (Fox et al., 2018). Si extraire l’énergie des courants de marées, prévisibles, est une idée séduisante, peu de sites conviennent pour les installations. Cependant, un grand nombre de dispositifs marémoteurs sont actuellement en cours de développement (Fox et al., 2018). En France, un déploiement expérimental a eu lieu au niveau du raz Blanchard, lieu de passage d’un intense courant de marée. Les principales préoccupations environnementales liées à ces dispositifs ciblent les perturbations physiques, les risques de collision, les modifications hydrographiques et la génération de bruits et de champs électromagnétiques (Fox et al., 2018). En termes de risques de pollution, on dispose de peu d’informations sur les revêtements anti-biofouling, c’est à dire contre l’encrassement biologique, qui devront être utilisés pour protéger les turbines, transformateurs et autres appareils (Fox et al., 2018).
L’augmentation du trafic maritime en général menace particulièrement les populations de cétacées, dites “espèces parapluie”, qui sont également confrontées à la perte d’habitat et aux pêcheries commerciales (Pennino et al., 2017). Le trafic maritime engendre des perturbations physiques et acoustiques qui peuvent provoquer, à court terme, des changements physiologiques et de comportement et, à long terme, des changements dans la distribution des cétacés. En outre, les collisions avec les navires sont régulièrement signalées. Des preuves de collisions ont été décrites pour 11 espèces de grandes baleines, pour lesquelles le rorqual commun (Balaenoptera physalus), était le plus fréquemment impliqué (Pennino et al., 2017). En particulier, la navigation de plaisance, en développement à travers le monde, est d’autant plus impactante, qu’elle est un des piliers de « l’économie bleue » ou la Blue Economy de l’Union européenne et a donc vocation à se développer : aujourd’hui, 36 millions de citoyens européens participeraient régulièrement à des activités de plaisance, le secteur du tourisme nautique de l’Union européenne créerait jusqu’à 234 000 emplois et génèrerait 28 milliards d’euros de recettes annuelles (Carreño et Lloret, 2021).
Enfin, du fait de l’augmentation de la population urbaine et du tourisme de masse, les zones côtières sont particulièrement touchées par une urbanisation rapide. À titre d’exemple, en région Provence-Alpes Côte d’Azur (Paca), un quart des zones qui ont été urbanisées au cours de la période 1990-2012 se trouvent dans les 15 premiers kilomètres de la côte (Doxa et at., 2017). Cette urbanisation entraine la perte d’habitats naturels. De plus, les habitats côtiers se distinguent souvent par une diversité végétale unique et une spécialisation élevée au sein de forts gradients écologiques à de petites échelles spatiales telle que l’adaptation à des niveaux stressants de salinité, de sécheresse et de température par exemple (Doxa et at., 2017). De nombreuses plantes sont donc très vulnérables à la diminution de leurs habitats : cela rend la priorisation des actions de conservation au sein des zones côtières particulièrement urgente (Doxa et at., 2017).
Les réponses des espèces à ces perturbations sont variables : un changement de comportement comme la modification des directions de nage, une augmentation de la durée de nage, une augmentation de la cohésion de groupe, des changements physiologiques telle que la respiration chez les dauphins, voire un évitement saisonnier de certaines zones (Carreño et Lloret, 2021).
Le transport des macro-déchets est aérien, fluvial ou par déversement direct. Il existe une grande variété de sources de déchets tant terrestres que marines. Les sources identifiées comme étant d’origine terrestre comprennent les décharges municipales et sauvages, les détritus des plages et zones côtières, le tourisme, les rivières et autres émissions industrielles et agricoles, les rejets provenant des égouts pluviaux et municipaux non traités. On estime que les sources terrestres contribuent actuellement à 80 % des déchets marins (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021). Les sources importantes d’origine maritime incluent le fret, la navigation de plaisance et militaire (notamment les croiseurs), la pêche industrielle et les installations aquacoles, mais aussi l’industrie de l’énergie.
Dans l’Atlantique Nord-Est, les principales sources de déchets sont liées aux activités maritimes telles que la navigation, la pêche, l’aquaculture et les installations offshore, ainsi que le tourisme côtier (e.g. bateaux de plaisances, pêche amateur) (Ospar, 2009). Aussi, la perte, l’abandon volontaire ou l’élimination des engins de pêche est la cause principale de la production de déchets par la pêche professionnelle / industrielle (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021).
Le trafic maritime et l’aquaculture jouent un rôle clé important et prépondérant dans l’introduction des espèces envahissantes à l’échelle mondiale et régionale. Les différentes infrastructures existantes liées à ces activités tels que les marinas et les ports maritimes forment des réseaux denses le long des côtes et sont capables d’abriter de nombreux taxons d’espèces envahissantes. Ces infrastructures sont susceptibles d’être une source importante de propagules permettant par ailleurs la colonisation des milieux naturels voisins. Les fermes aquacoles sont également une autre source importante d’espèces envahissantes. L’algue comestible Undaria pinnatifida, originaire d’Asie et introduite en Europe dans les années 1970, est un exemple phare d’une EEE qui se développe dans les habitats avoisinants des sites aquacoles (Rotter et al. 2020). Les évènements d’introduction, dits “spillovers”, peuvent se produire à partir des sites d’aquaculture, comme illustré aussi par l’huître creuse Crassostrea gigas, une espèce originaire du nord-ouest de l’océan Pacifique. La propagation de ces espèces dans les sites naturels entraînent des modifications importantes de l’habitat, mais aussi du fonctionnement des écosystèmes. Elles peuvent également participer au développement de nouvelles maladies et de nouveaux parasites entraînant alors des modifications génétiques suite à des phénomènes d’hybridation avec les taxons indigènes (Rotter et al. 2020).
En mer Méditerranée, la création et l’ouverture de canaux artificiels, tel que le canal de Suez, est parmi les voies d’introduction les plus significatives, permettant la colonisation progressive des espèces, notamment d’origine indo-pacifique. Une espèce de décapode, Charybdis longicollis, a été introduite passivement, en mer Méditerranée via le canal de Suez par les courants marins, et a depuis largement établi des populations dans le bassin Levantin, la subdivision du bassin oriental de la mer Méditerranée. Une analyse prospective (cf. Tsiamis et al. 2019) a classé la gestion des populations de cette espèce comme “impossible”. Ces espèces introduites ont principalement affecté les parties orientales du bassin.
Le trafic maritime est une des sources importantes d’introduction. Sa particularité est qu’il touche des zones généralement plus étendues, en raison du déplacement des navires, que les introductions dues à l’aquaculture, les canaux artificiels ou les courants marins (Katsanevakis et al. 2016). Cette introduction, principalement “accidentelle”, se fait généralement par le biais des navires (navires de charge, navires rouliers, caboteurs, etc.) via les réservoirs d’eau de ballast, ou l’encrassement biologique dit “biofouling” de la coque des bateaux (Rotter et al. 2020). Dans l‘étude de Tsiamis et al. 2019, 26 espèces sont classées comme étant prioritaires et principalement introduites par les navires (biofouling des coques et eaux de ballast) empruntant le canal de Suez comme accès à la Méditerranée. L’étude de Katsanevakis et al. 2016 recense, de son côté, les espèces introduites par la navigation maritime présentant les scores d’impact les plus élevés. En Méditerranée, les espèces introduites par les voies de navigation maritime sont celles ayant le plus d’impacts dans de nombreux sites du centre et du nord-ouest du bassin méditerranéen, y compris le littoral oriental français, comme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Corse (Katsanevaki et al. 2016).
S’il participe très largement à l’introduction et l’établissement pérenne des espèces non-indigènes en mer méditerranéenne (Guzinski et al. 2018), le trafic maritime est également une des sources majeures de propagation des EEE dans d’autres régions océaniques à travers le monde.
Aujourd’hui, les habitats les plus à risques sont les fonds durs sublittoraux peu profonds, les fonds mous sublittoraux peu profonds et l‘espace intertidal rocheux (Katsanevaki et al. 2016).
Les communautés côtières sont en première ligne de deux facteurs importants et croissants du changement global : le changement climatique, le développement économique, qui peuvent interagir avec la possible expansion de la conservation par zone, conduisant à ce que certains auteurs appellent la « triple exposition ». Si les stratégies visant à maximiser les avantages sociaux des politiques d’adaptation à ces trois facteurs diffèrent, des processus externes peuvent parfois converger pour amplifier les vulnérabilités et les inégalités. Les injustices sociales préexistantes peuvent augmenter la sensibilité des populations aux changements sociaux, environnementaux et politiques, et peuvent limiter leur capacité à s’adapter ou à bénéficier des impacts interactifs de ce qui est parfois appelé “la triple exposition”.
Dans un article publié dans la revue One Earth le 17 février 2023, le groupe de recherche en socio-écologie Blue Justice, financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité (Cesab), soutient, au-delà de la reconnaissance d’une telle “triple exposition”, que les agences de mise en œuvre externes ne peuvent pas atteindre efficacement et équitablement les objectifs d’adaptation climatique, économiques et de conservation sans donner la priorité à la justice sociale et au renforcement de la résilience en générale.
Pour faire avancer cette orientation vers la justice et la résilience, Joachim Claudet – chercheur CNRS, David Gill, chercheur à Duke University (États-Unis), Jessica Blythe – chercheuse à Brock University (Canada), porteurs du projet Blue Justice, recommandent que les acteurs du climat, du développement et de la conservation ambitionnent :
Dans un monde en mutation rapide, ces stratégies, appliquées ensemble et adaptées au contexte local, offrent une opportunité de développer des initiatives côtières qui soutiennent le bien-être, la justice et la résilience des populations côtières.
Des mesures qui prennent tout leur sens lors de catastrophes naturelles
Pour illustrer leurs recommandations, les auteurs mettent en avant plusieurs exemples, notamment en lien avec les catastrophes naturelles. Ainsi, en 2020, alors que les efforts internationaux étaient mobilisés par la pandémie, une marée noire est survenue à l’île Maurice. C’est un groupe d’ONG locales qui s’est mis en place pour activer son réseau de bénévoles et fournir les ressources nécessaires aux premières actions de nettoyage. Le vide institutionnel initialement ressenti a contribué à la large mobilisation des communautés locales pour la fabrication et le déploiement d’un filtre “anti-marée” dans la mer. Loin d’entraver cet engagement, les institutions gouvernementales ont ensuite fourni du soutien aux groupes bénévoles jusqu’à ce que des services spécialisés de nettoyage soient formellement mobilisés et que les efforts officiels commencent. Ceci illustre donc bien l’importance des partenariats inclusifs dans la lutte face aux pressions environnementales.
Le projet Blue Justice réunit un panel international (Amérique du Nord, Angleterre, France, Australie, Fidji, Italie, etc.) de spécialistes en biologie marine, biologie de la conservation, socio-écologie et lois environnementales.
Quel a été le point de départ à l’origine de la création de La Salamandre ?
Tout a commencé par une enfance à la campagne, remplie de balades dans la nature, qui m’ont permis de satisfaire la curiosité que j’avais pour le monde du vivant. Quand j’étais enfant, j’ai très vite eu conscience que la nature déclinait, ce qui a suscité beaucoup de colère et de tristesse. Alors je me suis demandé ce que je pouvais faire, à ma modeste échelle. Et comme j’avais beaucoup de plaisir à partager cette passion pour la nature, je me suis dit que j’allais créer un petit journal avec le peu de moyens que j’avais. J’ai commencé à taper sur une vieille machine à écrire héritée de mon grand-père. J’ai d’abord écrit sur les crapauds, les pissenlits, les hirondelles, etc. Et La Salamandre est née. Depuis les choses ont bien changé ! Aujourd’hui, les jeunes feraient un podcast, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, mais à l’époque tout ça n’existait pas encore.
Quels sont les principaux objectifs que vous aviez en créant la revue ?
Pour nous, l’objectif n’est pas que les gens connaissent la biodiversité dans ses moindres détails. On ne veut pas former de parfaits naturalistes. Notre but est de reconnecter les gens au monde du vivant en passant par les émotions. On essaie de raconter des histoires pour créer de l’empathie. En étant touché par ces histoires, le vivant reprend de la valeur.
Comment faites-vous pour continuer à toucher le public ?
Pour toucher le plus de monde, nous essayons de multiplier les formats. En plus des différentes revues que l’on propose, nous éditons entre dix et quinze livres chaque année. Nous produisons aussi des documentaires animaliers et nous organisons un grand festival annuel en Suisse. Aujourd’hui, nous essayons de mettre davantage l’accent sur le numérique pour toucher les jeunes. Une des spécificités de La Salamandre est de véhiculer un message très positif, même s’il est de plus en plus difficile. On a tous besoin de ça, de continuer à montrer le beau et le positif pour que les humains continuent à prendre soin d’eux en prenant soin de la nature.
Pensez-vous que réapprendre au public à observer la vie sauvage peut permettre de retisser durablement les liens entre l’humain et la nature ? Le prochain rapport de l’Ipbes consacré à l’utilisation durable des espèces sauvages traitera de l’observation de la nature comme d’une activité « non extractive ». Elle n’est donc pas sans impact…
Comment peut-on se sentir concerné par quelque chose avec lequel on a complètement perdu contact ? Si je vis en ville et que je passe la moitié de mon temps les yeux collés à un écran, comment puis-je me sentir concerné par la protection de la forêt, des oiseaux et des insectes ? Il est indispensable de retisser le lien entre l’humain et la nature. Aujourd’hui, les écosystèmes naturels subissent des pressions sans précédent, la population humaine ne cesse de croitre et le simple fait d’aller dans la nature et de l’observer peut avoir un effet délétère. Pendant la pandémie de la Covid-19, les gens ont moins voyagé pendant environ 2 ans, ce qui a été une bonne chose pour la biosphère. Mais d’un autre côté, la pression sur les écosystèmes provoquée par les loisirs de plein air s’est intensifiée. Ce paradoxe-là n’est pas facile à gérer. Notre rôle est de recréer du lien en invitant les gens à sortir, certes, mais aussi à observer, à s’émerveiller et à remettre en question certains de leurs comportements et de leurs pratiques.
Considérez-vous que l’éducation à l’environnement puisse être un réel changement transformateur ?
Malheureusement, je crois que jusqu’ici, force est de constater qu’elle ne l’a pas été. Ça fait quarante ans que c’est mon métier et qu’avec mon équipe nous sensibilisons des centaines de milliers de gens, à côté de nombreuses autres organisations qui le font à plus grande échelle encore. Pourtant, le monde continue de courir à la catastrophe. Je pense qu’il faudrait changer d’échelle pour que cela devienne un changement transformateur. Dans nos sociétés occidentales, aujourd’hui, il y a un vrai problème culturel, notamment en France. La nature n’est pas considérée comme un sujet important ou même sérieux. Au premier plan, il y a la culture, toutes ces œuvres magnifiques que créent les humains. Aujourd’hui, on parle de sujets comme la protection de la ruralité ou de questions comme celles liées aux pratiques de chasses. Mais au fond, la biodiversité n’a pas l’air d’être culturellement quelque chose d’important. Ça évolue dans le bon sens, bien sûr, mais encore trop lentement. Je pense qu’il y a encore cet héritage des philosophes du siècle des Lumières qui est bien ancré dans les mentalités. Il faut comprendre qu’en détruisant la nature, on détruit l’être humain.
Comment remédier à ce constat d’échec ?
J’ai récemment rencontré le philosophe Baptiste Morizot dont je trouve la pensée très nourrissante et dont je partage le diagnostic. Le mot de « nature » accumule un peu les casseroles. Déjà la nature, c’est futile par rapport à cette magnifique culture créée par les humains. Et c’est aussi un peu infantilisant. A la rédaction, on s’en rend bien compte. Quand on présente notre travail à des personnes qui ne nous connaissent pas, ils nous répondent souvent : « Ah, c’est super ! Je vais montrer ça à mes enfants ». Or, la nature est un sujet sérieux qui concerne tout le monde. Le mot de nature est presque devenu infantilisant. Je pense que la première chose à faire est de changer le discours et de parler par exemple de « monde vivant », qui est bien plus puissant car il nous inclut directement. Ensuite, il faut être plus attentif à nos systèmes éducatifs. Il y a une véritable révolution à faire dans ce domaine.
Participez-vous à cette révolution de l’éducation ?
Complètement. Nous avons édité un livre qui s’appelle « L’école à ciel ouvert », un manuel pour les enseignants qui respecte les programmes des écoles suisses et françaises. Le propos de ce livre est de montrer aux enseignants que tout peut être appris dans la nature. On peut faire des mathématiques, de l’anglais, de la physique et de la géographie dans la forêt. Le but n’est pas juste de faire des sorties dans la nature une fois par mois pour apprendre le nom des arbres, mais de faire toute l’école en lien avec le monde vivant. Les vertus pédagogiques sont nombreuses ! Les enfants peuvent établir un vrai lien à la nature, tout en bénéficiant d’un cadre sain et propice à l’expérience. C’est encourageant, car ce livre rencontre un grand succès, encore aujourd’hui. Ce genre d’initiative est importante, parce que là, on est sûr de toucher tout le monde. En visant les écoles, on touche aussi les adultes. On entend souvent le discours qui consiste à dire que « c’est important de sensibiliser les jeunes, car ce sont eux qui dans 20 ou 30 ans vont devoir corriger nos erreurs ». Mais on ne peut plus dire cela aujourd’hui. Les changements doivent venir maintenant. En sensibilisant les enfants, ils deviennent des alliés pour amener à des changements de comportements des adultes, peut-être de manière plus rapide qu’en sensibilisant directement les adultes. Les enfants sont un peu comme des catalyseurs de changements sociétaux. En les sensibilisant, notre cible est aussi les adultes qui sont les décideurs d’aujourd’hui.
Quel a été pour vous le point de bascule qui vous a poussé à vouloir faire évoluer le commerce des produits de la pêche ?
Au début de ma carrière d’ingénieur agro-halieute, je me suis retrouvé pendant un an sur les bateaux et j’ai pris conscience de tout ce que j’avais théorisé pendant mes études. C’est-à-dire que les pêcheurs ne savent jamais ce qu’ils vont attraper, ni quand ils vont pouvoir sortir en mer, ni même combien ils vont pouvoir vendre leurs prises : bref, ils sont soumis à une grande instabilité. Le plus souvent, j’ai rencontré des équipages déçus d’avoir trimé dans la tempête pendant plusieurs heures pour finalement très mal vendre leur produit. Certains me disaient : “Moi, je vends en direct. De cette manière, je valorise mieux mon poisson et je peux me permettre de ne pas aller en mer quand le temps est mauvais”.
Qu’avez-vous mis en place pour répondre à cette prise de conscience ?
Au début, pas grand-chose… Je me suis retrouvé à travailler à la direction des pêches du ministère de l’agriculture où je subventionnais des projets de recherche et développement ou d’investissements à bord de navires. Mais petit à petit, je me suis intégré dans les systèmes d’Amap et j’ai découvert ces offres de paniers avec de super produits, bons, provenant directement du producteur, bien payés et issus de pratiques vertueuses. Là, je me suis dit qu’il fallait faire la même chose avec la pêche.
Quelles sont les valeurs que cherchent les consommateurs en se tournant vers vous ?
Récemment, nous avons fait un sondage auprès de nos abonnés. On distingue deux cas. Les plus anciens clients nous disent que c’est la qualité du produit et le goût qui fait la différence. Je pense que l’on n’est pas tombé dans l’écueil de certains produits issus du commerce équitable ou du vin bio qui proposent de bonnes valeurs mais qui n’offrent pas de bons produits. Pour les abonnés plus récents, la différence se fait sur l’engagement de durabilité qui est associé à une certaine valeur de confiance. Aujourd’hui, les gens se méfient des labels. Nous mettons en avant des produits frais, durables et éthiques, avec derrière une véritable transparence et de vrais critères.
Qu’est-ce qui fait que votre activité est durable ?
D’abord, nous travaillons avec certains types de navires de manière exclusive. C’est-à-dire que nous ne mettons dans nos paniers que des produits issus de la petite pêche côtière. Concrètement, cela signifie que nous ne travaillons qu’avec des bateaux de 12 mètres au plus qui sortent à la journée uniquement et qui embarquent trois marins au maximum pour la pêche au filet. Mais nous avons aussi des critères techniques. Nous ne travaillons qu’avec des pêcheurs qui utilisent des techniques douces ou passives. Concrètement, il s’agit d’engins que l’on pose dans l’eau et que l’on revient chercher plus tard comme des hameçons, des lignes, des casiers ou des filets. Nous valorisons aussi la pêche à la main, en plongée ou à pied. Évidemment, nous refusons de travailler avec des pêcheurs qui utilisent des chaluts ou des dragues qui, selon les scientifiques, abîment les fonds marins. Nous faisons aussi attention à la sélectivité : nous achetons ce qui est pêché, même s’il s’agit de poissons peu connus par le consommateur.
Comment rémunérez-vous vos pêcheurs ?
Aujourd’hui, c’est assez hétérogène. Il y a les poissons les plus demandés payés quasiment au prix du marché, comme les bars, les soles ou les turbots. Et pour les espèces moins connues, nous payons beaucoup plus. Globalement, nous nous engageons à payer 20 % de plus que le marché.
Qui sont les pêcheurs qui travaillent avec vous ?
On rencontre des pêcheurs qui sentent que leur filière n’est pas assez valorisée. Il n’y a pas de “bio” pour la pêche, donc pas de possibilité pour les pêcheurs d’afficher clairement leurs pratiques vertueuses. Pour moi, un défaut des certifications “pêche durable”, c’est qu’elles veulent absolument raisonner à l’échelle de la pêcherie et non à celle du pêcheur. Je pense que tout pêcheur ayant des pratiques objectivement vertueuses devrait pouvoir être labellisé. Ce sont ces pêcheurs-là que l’on va chercher, ceux qui n’arrivent pas à travailler à petite échelle parce que la filière ne les met pas en valeur et ne les rémunère pas assez. On travaille aussi avec de nombreux pêcheurs qui s’installent, qui font peu de volume et pour lesquels il est plus facile de vendre aussi les espèces habituellement dénigrées par le marché.
Pour les pêcheurs, ça change quoi concrètement ?
Ce que nous voyons aujourd’hui avec les sondages que l’on fait auprès de nos pêcheurs, c’est que 30 % d’entre eux nous vendent des espèces qu’ils jetaient à la poubelle auparavant. En réduisant ce gaspillage, on réduit considérablement la pression sur les autres espèces habituellement plus exploitées. D’autres nous déclarent pouvoir se permettre de mettre moins d’engins en mer, de passer moins de temps à pêcher, de mettre moins de longueurs de filets, ce qui, encore une fois, réduit la pression de pêche.
Est-ce que ce système peut s’étendre à une plus grande échelle et devenir un vrai changement transformateur ?
C’est le rêve que l’on avait au départ. Nos objectifs premiers sont d’assurer des bons prix toute l’année et de voir, grâce à ce système de paniers qui assure l’écoulement de nos produits, que les stocks de poissons s’améliorent. D’ailleurs, nous avons des scientifiques qui évaluent actuellement notre impact en mesurant l’activité des bateaux, les quantités attrapées et les nombres de jours passés en mer. Vendre du poisson, c’est juste un moyen d’arriver à cette fin, de créer un levier en payant mieux les pêcheurs, au lieu d’attendre que les stocks de poissons soient dégradés à un tel point qu’il faille soumettre les pêcheurs à des mesures coercitives comme l’instauration de quotas parfois inadaptés et en décalage avec la réalité économique.
Quels sont vos prochains challenges ?
La prochaine étape, c’est d’inciter de nouveaux professionnels à se conformer à nos critères de durabilité, pour valoriser le mouvement des nouveaux pêcheurs qui s’installent et qui pratiquent la pêche à la ligne ou au casier. Il faut les aider à transformer plus en profondeur la filière. Aujourd’hui, il y a un vrai risque de rachat des petits bateaux. L’idéal serait de faire l’inverse : sanctuariser de petits bateaux, voire acheter des gros bateaux pour les transformer en petits. Le jour où l’on arrivera à obtenir un volume suffisamment important et où l’on pourra dire à un pêcheur qui fait 50 tonnes de poissons dans l’année qu’on est là pour lui, on deviendra un vrai levier.
Du 9 au 11 février s’est tenu à Brest le premier One Ocean Summit, un sommet international qui a permis de concrétiser des engagements en faveur de la protection des mers et des océans. Les écosystèmes marins sont en effet menacés à la fois par des facteurs globaux (tels que le réchauffement de l’eau et l’acidification des océans), mais aussi par des facteurs locaux (tels que la pêche, la pollution lumineuse ou encore la navigation). Les facteurs de pression étant directement associés aux activités humaines, les écosystèmes les plus éloignés des humains devraient intuitivement subir moins d’impacts et constituer des refuges plus sûrs pour la biodiversité. Cette idée est d’ailleurs confortée par plusieurs études scientifiques qui démontrent l’existence d’une corrélation claire entre l’état des écosystèmes et leur distance par rapport aux grandes villes (Figure 1). Pour cette même raison, les zones les plus éloignées sont aussi considérées comme des réservoirs potentiels de biodiversité qui peuvent préserver les écosystèmes en cas d’extinction importante.
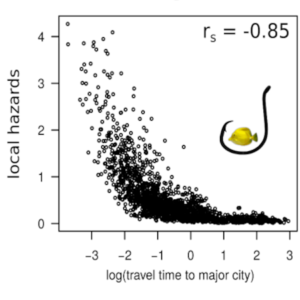
Figure 1. L’impact des activités anthropiques, ou leurs conséquences (tels que la pêche, la pollution) sur les communautés des poissons des récifs coralliens diminue avec l’éloignement aux activités humaines. Chaque point correspond à une zone de récifs coralliens à une résolution spatiale de 1 × 1 degré de latitute/longitude. Modifié de Strona et al. 2021b (CC BY 4.0).
Cependant, des études menées au sein du projet de recherche Score-Reef, co-financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) à travers son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Ministère de la transition écologique (MTE), montrent que la réalité est tout autre lorsque l’on prend en compte la dépendance des poissons vis-à-vis des récifs coralliens.
Le deuxième volet de cette campagne est consacré à l’exploitation des ressources naturelles par les humains.
Comment rendre durable la gestion des forêts tropicales ou celle de la pêche ? Que nous apprennent les systèmes alimentaires des peuples autochtones sur nos modes de consommation et notre lien au sauvage et à la nature ?
Découvrez tous les articles :
IA et biodiversité : des synergies à développer pour préserver la planète
Souvent considérés comme notre « dernière frontière », les océans couvrent environ 71 % de notre planète et concentrent une part essentielle de la biodiversité. Étudier la biodiversité et son évolution représente donc un enjeu scientifique et sociétal majeur pour répondre aux défis posés par le changement climatique et contribuer aux Objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies.
La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) estiment que la structuration des données reste l’un des freins majeurs à la connaissance de la biodiversité. Face à la complexité des interactions entre les écosystèmes et à l’hétérogénéité des données, les indicateurs actuels restent limités dans la prédiction des évolutions de la biodiversité, notamment en milieu marin.
L’IA a un potentiel significatif pour répondre à ce défi. En proposant de nouvelles solutions pour collecter, structurer et valoriser les données, l’IA peut fournir des ressources inédites afin de dresser une photographie actuelle de l’état de la biodiversité et de prédire son évolution. Appliquées au milieu marin, ces innovations permettent d’avancer vers le quatorzième ODD, qui promeut la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers.
Partant de ce constat, un appel à projets « Challenge IA-Biodiv » a été lancé en mars 2021. Cet appel est destiné aux communautés scientifiques de l’IA et de la biodiversité afin de mettre en commun leur expertise. Les projets devront répondre à trois objectifs :
Ce challenge international s’inscrit dans la dynamique du volet « recherche » de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle (SNIA) lancée en 2018 afin de renforcer la position de la France dans ce secteur. Il répond à un véritable enjeu d’innovation partagée en impulsant des logiques de co-construction de nouveaux outils.
Les trois projets lauréats du Challenge IA-Biodiv
À l’issue du processus d’évaluation et de sélection mobilisant un panel de chercheurs internationaux indépendants, trois projets portés par des équipes pluridisciplinaires et internationales de chercheurs spécialisés dans le domaine de l’IA et de la biodiversité ont été retenus :
Ce projet a pour objectif de relever trois défis scientifiques : (1) la combinaison ou l’hybridation des techniques en IA afin d’améliorer la justesse et la précision des indicateurs de biodiversité ; (2) le développement d’indicateurs, à plusieurs échelles, capturant les divers aspects de la santé et des pressions pesant sur les écosystèmes marins ; et (3) leur intégration dans un modèle d’IA capable d’expliquer et de prédire la dynamique spatio-temporelle de la biodiversité marine dans des études de cas. Le projet AIME fournira de précieux outils pour accompagner les prises de décision dans les stratégies de gestion des écosystèmes marins côtiers.
Il développera de nouvelles méthodes de gestion et d’intégration des données de la biodiversité des espaces marins côtiers à partir d’algorithmes d’apprentissage automatique pour compléter les données manquantes et construire des indicateurs adaptés pour évaluer la biodiversité des espaces observés. Ce projet propose également de mettre à disposition de la communauté scientifique de grands jeux de données constitués de millions d’images d’organismes planctons.
Ce projet ambitionne de générer des indicateurs écologiques et des modèles prédictifs de la biodiversité des écosystèmes perturbés en combinant des méthodes d’intelligence artificielle aux approches évaluatives connues. Il permettra ainsi de créer la première base de connaissance de biodiversité marine et, par la suite, de développer des modèles de prédiction et d’interprétation. Il vise également à dévoiler des solutions intelligentes pour la nature afin d’assurer la durabilité des systèmes socio-écologiques côtiers.
Le challenge, une modalité originale de recherche collaborative
À l’heure où les défis planétaires sont de plus en plus nombreux et complexes, il devient essentiel d’innover et d’encourager le partage des savoirs pour trouver des réponses appropriées. Instrument de financement spécifique de l’ANR, le Challenge permet d’y répondre, en explorant simultanément différentes approches scientifiques ou technologiques autour d’une même problématique et en mettant en commun les solutions. Il confronte et partage les approches et travaux des consortiums financés, et favorise l’établissement de références communes entre des communautés scientifiques d’horizons divers.
Le Challenge IA-BIODIV sera animé par le consortium opérationnel (COpé), composé du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), pilote du COpé, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) via l’infrastructure du Pôle national de données de biodiversité (PNDB).
Ainsi, les trois équipes de recherche retenues vont travailler à l’élaboration et au développement de leur projet de manière collaborative et se rencontrer à l’occasion du démarrage du Challenge le 23 février 2022. Leurs travaux, planifiés par le Copé sur 4 ans, porteront sur le milieu marin côtier en mer Méditerranée lors des deux premières années et se concentreront sur l’océan Pacifique les deux dernières. À partir de jeux de données communs, les équipes répondront chacune à des enjeux spécifiques et complémentaires sur la biodiversité marine.
Le COpé jouera un rôle central dans l’organisation et le bon déroulement du challenge : en qualité de tiers de confiance, il assurera l’animation scientifique, l’évaluation des systèmes d’IA, la constitution de jeux de données et leur accès via l’environnement « IA-BiodivNet ». Les trois consortiums de recherche exploiteront et enrichiront de manière collaborative cet environnement numérique pendant toute la durée du Challenge. Ils auront accès aux ressources de calcul intensif de GENCI (Grand équipement national de calcul intensif). La plateforme sera, à terme, accessible à tous scientifiques et chercheurs et contribuera à la diffusion de jeux de données pérennes pour les futurs travaux scientifiques en IA et dans le champ de la biodiversité.
L’exploitation des organismes n’est pas durable lorsque le prélèvement d’individus d’une population se fait au-delà du taux de renouvellement et de l’accroissement biologique de celle-ci, ou lorsque l’activité conduit à une dégradation de l’environnement qui perturbe cette espèce (par exemple, l’écotourisme intensif). Cette exploitation correspond à un service écosystémique d’approvisionnement – et aux contributions matérielles de la nature (dans la typologie de l’Ipbes) – lorsqu’elle vise à se nourrir, se vêtir, se chauffer ou se loger par exemple. Elle correspond à un service culturel – et aux contributions immatérielles de la nature – dans le cas d’activités récréatives ou spirituelles. Au niveau mondial, l’Ipbes estime qu’il s’agit de la 2e cause principale de perte de la biodiversité.
La pêche, la chasse, la cueillette et l’exploitation des forêts naturelles (par opposition aux plantations) sont les principales formes d’utilisation des espèces sauvages, entraînant un prélèvement dans la nature. Certaines activités sans prélèvement représentent également une forme d’utilisation.
La pollution correspond à une dégradation de l’environnement par des substances, des déchets ou des nuisances diverses. Il peut s’agir de particules fines, de gaz à effet de serre, de métaux lourds, de substances chimiques ou de matériaux non dégradables comme les plastiques. Les pollutions sonores et lumineuses présentent également un fort impact sur le fonctionnement et la santé des écosystèmes mais sont encore relativement peu étudiées. Elle concerne différents types de milieux : l’atmosphère, les sols, les rivières ou les océans. Ingérée, respirée, entravante ou dérangeante, la pollution de l’environnement affecte la santé de toutes les espèces, y compris les humains. La meilleure solution face à l’augmentation des déchets et des polluants est de réduire drastiquement leur production et leur utilisation, sans engendrer de nouvelles pollutions.
Ces Rencontres visent à rassembler en ateliers différents acteurs (chercheurs, responsables de politiques publiques, acteurs de terrain, etc.) afin d’élaborer une série de recommandations grâce à une méthodologie basée sur la démarche prospective.
Pour cette édition, trois thèmes ont été identifiés :
Les recommandations issues de ces échanges devraient être publiées dans les mois à venir, à l’instar de celles issues des Rencontres de 2018 et 2017. Nous vous invitons à découvrir la vidéo d’ouverture de l’édition 2020.
Le premier volet de cette campagne est consacré à la notion de « valeurs » associées à la nature. En quoi évaluer et partager ces valeurs est un enjeu majeur pour la conservation de la nature et de la biodiversité ? En quoi la durabilité de l’utilisation d’espèces sauvages dépend du contexte culturel, politique et social ?
Des questions que viennent interroger et éclairer Virginie Maris (philosophe – CNRS), Florence Pinton (sociologue – AgroParisTech), Catherine Sabinot (ethnoécologue – MNHN), Frédéric Ducarme (philosophe – MNHN) mais aussi Sita Narayanan (Grand port maritime de Guadeloupe), Marika Dumeunier (Noé) et Hélène Leriche (Orée).
Découvrez tous les articles :
Pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour par le langage. Il n’y a pas de terme pour dire « nature » dans les langues kanak. La dichotomie entre nature et culture n’existe pas. Il s’agit plutôt de liens qui unissent les éléments, humains et non humains. Il s’agit donc pour les hommes et les femmes d’entretenir tous ces liens, entre le requin et le lézard, l’homme et l’igname, la femme et le cocotier, et tout ce qui nous lie à la « terre-mer ». Quand on est kanak, la « terre » ou la « nature », s’étend de la montagne jusqu’au récif, voire au-delà. Cela inclut les vivants et les morts, le monde visible et invisible.
Le lien qui unit les populations de Nouvelle-Calédonie avec la nature est très fort, car tout est lien. Aussi, ce lien est entre autres entretenu par la connaissance commune des toponymes, c’est-à-dire des noms de lieux. Chaque toponyme renferme la mémoire du lien d’un clan à la terre et toute son histoire. Grâce à ces toponymes, le lien au territoire persiste à travers les générations.
Sur l’archipel calédonien aujourd’hui très multiculturel et métissé, on ne peut pas dire qu’il n’y a qu’une seule perception de la nature. Ce que je peux observer, c’est que les premiers habitants d’ici, les Kanak qui constituent aujourd’hui un peu plus de 40 % de la population ont réussi à partager leur vision du monde, leurs liens forts à des éléments non-humains notamment. Même si cela n’est pas toujours évident pour tous, il y a une certaine reconnaissance de la diversité des savoirs et des représentations de la nature. Chaque communauté a apporté ces manières de voir et nombreuses sont les personnes qui se sont construites en intégrant un peu de cette diversité.
Au début, dans de nombreux pays du monde, gérer l’environnement consistait à “mettre la nature sous cloche”. Aujourd’hui, on intègre de plus en plus à la fois les habitants, leurs valeurs et leurs pratiques. En Nouvelle-Calédonie, les trois provinces possèdent chacune leur propre code de l’environnement. Celui de la province des îles Loyauté, habitées par une grande majorité de Kanak, a été rédigé il y a seulement trois ans. En amont, des travaux de recherche en sciences de la nature et en sciences sociales ont été menés afin de prendre en compte les enjeux écologiques ainsi que les spécificités des populations et du territoire. Pour vous donner un exemple, avec des collègues écologues, ethnologues et géographes, j’ai mené un travail sur les roussettes, de grandes chauves-souris, qui sont considérées comme des ancêtres dans certains clans et sont globalement très importantes d’un point de vue culturel. Notre travail a été fait pour que puissent être rédigées des réglementations qui s’appuient sur la vision des habitants, sur les pratiques préexistantes et sur les enjeux écologiques. Les règles sont pensées non pas pour protéger une biodiversité seule mais bien la biodiversité et la société. Par ailleurs, dans les codes de la province Sud et de la province Nord rédigés depuis plus longtemps, il est prévu que des dérogations soient possibles pour le prélèvement d’espèces comme la tortue verte à des fins coutumières (pour des mariages, des deuils, des intronisations de chefferies, etc.).
Il y a un certain effort d’intégration des décideurs et des acteurs locaux. Pour donner un exemple, six sites de Nouvelle-Calédonie sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les comités de gestion de chaque site sont généralement composés de représentants locaux (associations locales, coutumiers, femmes et hommes de l‘endroit). On considère volontiers que les acteurs locaux ont un rôle à jouer, mais selon les lieux, ils sont plus ou moins impliqués et écoutés. Il reste du travail à mener pour réellement prendre en compte leur parole et leurs visions.
Je vais utiliser un exemple pour vous répondre. Depuis quelques années, nous menons un projet appelé Espam sur le milieu marin, financé par la Fondation de France et la province des Iles Loyauté. L’objectif a été de travailler sur la diversité des valeurs que les habitants accordent aux territoires marins, en particulier aux animaux marins. L’idée est que si on connaît mieux les valeurs que les gens accordent aux espèces, et donc au territoire, et que l’on parvient à les faire reconnaître par le plus grand nombre, il sera possible de créer des politiques environnementales qui intègrent tant les enjeux écologiques que les enjeux culturels et sociaux. Elles seront ainsi plus ajustées et mieux comprises par tous.
Dans le cadre de ce programme, en plus de mener des entretiens longs avec les Calédoniens (de plus de 4 heures parfois), nous avons déployé un questionnaire très court contenant deux questions : “Quels sont les animaux marins emblématiques pour vous ?” et “Pourquoi ?”. Plus de 130 espèces différentes ont été citées, ce qui illustre nombre conséquent d’espèces importantes pour les populations locales. Nous avons créé une base de données nourrie de ces réponses sur les espèces et les valeurs que leurs accordent les habitants. 201 raisons différentes ont été données que nous avons classées en 22 grands thèmes. En Nouvelle-Calédonie, la fonction nourricière accordée aux animaux marins a été très largement citée, puis leur importance coutumière et leur statut d’espèce menacée ou à protéger. Ces résultats ont montré que les valeurs socio-culturelles sont prégnantes. Nous devons donc en tirer des leçons, cesser de tout vouloir traduire en valeur monétaire et créer des indicateurs multiples agrégeant des indicateurs sociaux, économiques et culturels. Trouver les outils à ces fins reste encore un défi mais nous pensons que ce projet apporte sa petite pierre à la réflexion.
Il s’agit d’une proposition de l’Ipbes qui résulte d’une analyse des causes de déclin de la biodiversité et des échecs politiques de sa préservation ces dernières décennies. Un changement transformateur est défini comme une réorganisation fondamentale et systémique des facteurs économiques, sociaux, technologiques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs.
>> En 2021, la FRB a consacré sa Journée annuelle à débattre de cette notion. + d’infos
L’idée sous-jacente est qu’il est possible de faire évoluer les valeurs qu’on porte aux choses et notamment à la nature. Il ne s’agit pas de faire converger les différentes valeurs, mais bien de faire valoir leur diversité. Celles-ci ont toujours évolué et on se rend plus compte aujourd’hui de l’existence de différentes manières de penser les choses. Notre mobilité entre les continents, entre les îles, s‘est accélérée et étendue, ce qui conduit aujourd’hui à avoir des territoires habités par une grande diversité de populations ; et chacune établit un lien spécifique avec la terre qu’elle habite. Le système des valeurs caractérisant un territoire devient plus complexe et plus riche. Selon moi, on peut profiter de cette richesse et de cette complexité afin d’analyser la diversité des valeurs, et ce qui conduit chacun à faire évoluer son système de valeurs, notamment pour renforcer ces liens avec les éléments de la nature. J’aime penser que notre objectif n’est pas de protéger l’environnement ou la société, mais bien l’ensemble : les liens humains-natures, les liens entre les humains et les non-humains. Si on arrive à identifier ces changements transformateurs et les manières institutionnelles, collectives et individuelles de les favoriser, on pourra alors renouveler un lien sain entre la biodiversité et la société. Pour préserver cet ensemble, il faut les penser ensemble. La vision kanak du monde, marqués par les liens, peut nous aider. L’attention portée à maintenir ces liens dans le présent doit guider nos actions.
Les modes de production et de consommation pour répondre à cette demande entraînent des changements d’utilisation des terres et des mers, c’est à dire des changements d’occupation et d’utilisation des sols et des ressources, liés aux activités humaines. Le changement d’usage des terres est reconnu comme la cause première d’érosion de la biodiversité sur la planète.
Les huit projets sélectionnés dans ce cadre couvrent les défis de recherche allant de la compréhension des impacts de l’acidification à leur modélisation, en passant par l’observation et la cartographie du phénomène.
Financé par le Ministère de la transition écologique, ce programme a permis le regroupement des expertises scientifiques autour de ce sujet, mais aussi le dialogue recherche et décideurs publics et privés face aux enjeux environnementaux et socio-économiques qui s’annoncent dans les prochaines décennies. Les colloques de Nantes en 2019, et de Brest en 2021, en sont les parfaites illustrations.
Ce séminaire de restitution permet avant tout de présenter les résultats de ces projets à la communauté scientifique. Un temps de conclusions et d’échanges sur les perspectives du programme et des projets est ensuite prévu ; ce temps s’adresse plus particulièrement à un public de décideurs et financeurs de la recherche.
Il est désormais clair que la biodiversité est au cœur des débats sociétaux et de l’agenda politique planétaire. Son avenir et les actions à mettre en œuvre pour enrayer son déclin demandent plus d’ambition. Réunie au sein de l’Ipbes, pour plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l’expertise scientifique internationale appelle désormais à des changements transformateurs. C’est-à-dire, des changements profonds de nos modes de vie et de consommation qui passent par la réorganisation fondamentale des facteurs économiques, sociaux et technologiques qui les régissent.
Concrètement, quels sont-ils et comment les mettre en place ?
Qu’impliquent-ils pour les acteurs publics et privés, les décideurs politiques et économiques ? Quelles actions sont déjà menées ? Pour quels résultats ?
L’objectif est d’emprunter des trajectoires pensées de manière globale, intégrant à la fois les enjeux alimentaires, énergétiques, climatiques et environnementaux. Ainsi, consommer local, passer à une comptabilité environnementale, réinventer ses processus industriels, changer de modèle de gouvernance, repenser l’urbanisation de nos villes, sont autant d’exemple de mesures leviers à mettre en œuvre.
À l’occasion de la Journée FRB 2021, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité s’empare de ce sujet. Elle souhaite ainsi mettre en lumière les fondements scientifiques et les enjeux pour la recherche, articulant sa réflexion à partir d’ateliers menés en amont avec son Conseil scientifique et son Conseil d’orientation stratégique. Alors que l’Ipbes vient d’annoncer le lancement d’un rapport sur le sujet, la FRB propose un espace de dialogue aux chercheurs et acteurs, publics et privés, de la société afin de mieux en comprendre les contours pour oser les changements transformateurs.
Comment utiliser le deep learning pour les espèces rares des milieux marins telles que le dugong, ou furtives comme les requins, pour lesquelles peu d’images sont disponibles ? Des scientifiques de trois unités mixtes de recherche (MARBEC, ENTROPIE et LIRMM) viennent de publier une étude exploitant les dernières avancées technologiques, combinant vidéos sur les réseaux sociaux et suivis vidéos aériens, pour recenser des espèces charismatiques de la mégafaune marine de Nouvelle-Calédonie : dugongs, tortues et requins.
Ces travaux, intitulés « Exploiter les réseaux sociaux et l’apprentissage profond pour détecter la mégafaune rare à partir de suivis vidéo » et publiés dans la revue internationale Conservation Biology, sont en partie issus du projet de recherche Pelagic financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), et s’appuient sur la collecte de vidéos aériennes financée par les Explorations de Monaco.
L’acidité des océans a augmenté d’environ 26 % depuis l’époque préindustrielle. Ce phénomène causé par l’augmentation des rejets de CO2 liés à la combustion de combustibles fossiles et autres activités humaines est préjudiciable à de nombreuses espèces marines. Parmi elles, on retrouve les coraux ou encore d’autres espèces dont le squelette ou la coquille se composent de carbonate de calcium. Ces impacts, associés à l’augmentation de la température de la haute mer, à la stratification et à la désoxygénation des eaux souterraines risquent d’affecter la structure globale et le fonctionnement des écosystèmes marins entraînant ainsi des conséquences de grande portée et des impacts socio-économiques potentiellement profonds.
De nombreuses questions subsistent et les chercheurs s’interrogent notamment sur le potentiel des organismes marins à s’adapter à l’acidification des océans et aux implications plus larges pour les écosystèmes océaniques. Mais quels sont ses effets sur les écosystèmes marins et par conséquent sur l’économie maritime, notamment la pêche et la conchyliculture ? Comment agir et adapter les pratiques pour assurer la pérennité des métiers liés aux produits de la mer ?
Alors que le programme de recherche “Acidification des océans” touche à sa fin, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), le Ministère de la Transition écologique (MTE) et Océanopolis ont proposé des regards croisés en réunissant scientifiques, professionnels, gestionnaires et associations, pour partager expériences de terrain, bonnes pratiques ainsi que les résultats des projets scientifiques financés par le ministère de l’écologie.
L’Ipbes (la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) avait beaucoup fait parler d’elle lors de la 7e session plénière de ses États membres, qui s’était tenue à Paris en avril-mai 2019. Elle y avait notamment adopté sa première évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, qui a largement contribué à l’attention croissante accordée aux enjeux de biodiversité ces deux dernières années. Après une “année blanche” en 2020, l’Ipbes organise sa 8e session en juin 2021, qui se déroule exclusivement en ligne, situation sanitaire oblige.
Les deux principaux sujets à l’ordre du jour de cette plénière sont l’approbation de deux documents :
Ces rapports de cadrage constituent la commande passée par les États membres de l’Ipbes auprès des groupes d’experts pour les deux prochaines évaluations inscrites au programme de travail de l’Ipbes. Celles-ci se dérouleront respectivement sur 5 et 3 ans. L’adoption de ces documents en plénière participe à la priorisation des attendus et des sujets majeurs qui devront être abordés par l’Ipbes dans ses travaux.
La plénière examine également un rapport concernant la collaboration entre l’Ipbes et le Giec, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et un document sur le travail des “équipes spéciales” de l’Ipbes, des groupes transversaux permettant de renforcer les capacités et l’efficacité de la plateforme, de consolider les bases de connaissances et de soutenir les décisions politiques.
Cet évènement (en anglais) a rassemblé les parties prenantes de toutes les régions du monde, afin de favoriser les échanges et la coopération avec l’Ipbes.
Un récapitulatif des faits marquants et du programme de travail de l’Ipbes a été présenté. Les Stakeholder Days permettent aux parties prenantes de connaître davantage la manière dont elles peuvent s’impliquer dans le processus Ipbes et l’organisation du travail qui leur est demandé en préparation de la plénière.
Le travail effectué par le réseau ouvert des parties prenantes (ONet) et le forum international des autochtones sur la biodiversité et les services écosystémiques (IIFBES) ont été présentés. Les parties prenantes connectées ont également pu contribuer à l’élaboration des déclarations des parties prenantes, faites au cours de la plénière, en réaction au programme de travail de l’Ipbes. + d’infos
___________
Important – Pour participer à cet atelier, vous devez obligatoirement :
Cet atelier prendra la forme d’un World Café pour faciliter le dialogue et le partage de connaissances et d’idées. Vous aurez l’opportunité lors de cet atelier de contribuer à la réalisation de ce rapport, en apportant vos connaissances pratiques et techniques, et vos savoirs locaux et traditionnels. Il vous sera proposé de travailler sur le « résumé pour décideurs », document de référence produit par l’Ipbes et résumant l’évaluation. Il s’adresse, au-delà des décideurs publics, aux décideurs privés (monde de l’entreprise, associatif, ou à titre individuel).
Déroulé de l’atelier :
Si vous souhaitez participer à cet atelier, merci de vous inscrire au plus tard le 30 avril 2021.
+ d’infos :
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) s’est emparée de cet enjeu et publie, en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB), un rapport compilant les résultats d’une enquête menée auprès des parties prenantes, d’une évaluation scientifique d’outils de mesure intégratifs, d’ateliers réunissant acteurs et concepteurs d’outils, ainsi que les échanges issus d’un colloque.
À la lumière de ces travaux, la FRB propose trois constats et une série de recommandations visant à améliorer ces indicateurs et leur appropriation par les acteurs :
L’ampleur du travail restant à accomplir est importante, mais il est nécessaire de progresser rapidement alors que la question des indicateurs est au cœur de la préparation de l’agenda post-2020 et des engagements de la future COP 15. Concepteurs, chercheurs et acteurs doivent y travailler de concert. À ce titre, la FRB met en avant une série de recommandations, de démarches à adopter pour améliorer les indicateurs et outils de mesure existants et mieux intégrer la complexité du vivant et de nos relations au sein de ce vivant. Parallèlement, et de manière pragmatique, une veille sur la pertinence et la qualité des différents indicateurs et outils de mesure serait utile à l’ensemble des acteurs.
De son côté, l’OFB au travers de ses programmes de mobilisation des acteurs économiques, associatifs et institutionnels intitulés « Engagés pour la Nature » accompagne l’ensemble des parties prenantes et les encourage à agir.
« Entreprises Engagées pour la nature – Act4nature France » regroupe d’ores et déjà plus d’une centaine d’entreprises, de toutes tailles, opérant dans des secteurs d’activités et des territoires variés qui au travers des plans d’actions déploient des actions concrètes afin de faire évoluer leurs modèles d’affaire en y intégrant des enjeux de biodiversité.
« Partenaires engagés pour la nature » a permis de valider l’engagement de réseaux et fédérations professionnelles ainsi que d’associations qui se mobilisent afin de former et d’outiller leurs adhérents au travers la mise en partage de bonnes pratiques.
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) s’est emparée de cet enjeu et publie, en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB), un rapport compilant les résultats d’une enquête menée auprès des parties prenantes, d’une évaluation scientifique d’outils de mesure intégratifs, d’ateliers réunissant acteurs et concepteurs d’outils, ainsi que les échanges issus d’un colloque.
Des indicateurs de biodiversité et outils de mesure ont été développés dès les années 1990. Trois décennies plus tard, où en est-on ? Peut-on désormais répondre aux attentes fortes des acteurs de la société et des conventions nationales et internationales ? Et pour aller plus loin, que penser des analyses de cycle de vie, des labels de pratiques durables, en termes de pêche, déforestation, etc. ?
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) s’est emparée de cet enjeu et publie, en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB), un rapport compilant les résultats d’une enquête menée auprès des parties prenantes, d’une évaluation scientifique d’outils de mesure intégratifs, d’ateliers réunissant acteurs et concepteurs d’outils, ainsi que les échanges issus d’un colloque.
Le rapport complet ainsi que l’annexe avec les évaluations scientifiques de sept indicateurs et outils de mesure sont disponibles dans les ressources téléchargeables.
La 15ème réunion de la Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), qui doit se tenir en 2021, devrait déboucher sur un accord mondial en faveur de la nature, avec un consensus émergent visant à protéger au moins 30% de l’océan global d’ici 2030.
Les résultats de l’étude coordonnée par Enric Sala publiée en mars 2021 dans le journal Nature, donnent du crédit à cet objectif et suggèrent qu’une augmentation de la surface des aires marines protégées et une répartition spatiale cohérente de ces dernières pourraient avoir un triple avantage : non seulement mieux protéger la biodiversité marine par rapport à l’existant, mais aussi stimuler la productivité des pêcheries, en exploitant une moins grande surface mais avec de meilleurs rendements, et amoindrir les émissions de carbone remis en suspension par le chalutage profond.
La synthèse est disponible dans les ressources téléchargeables.
Au terme de cet appel qui visait à promouvoir des projets de recherche mêlant excellence scientifique et pertinence politique et sociétale, 21 projets ont été financés pour un montant de plus de 25 millions d’euros.
BiodivERsA organise le 5 mai prochain de 13h à 18h la conférence de lancement de ces projets. Participez à cette conférence et découvrez les 21 projets financés.
+ d’infos :
En utilisant la base mondiale des poissons récifaux collectée par le Reef Life Survey, une équipe internationale dont des scientifiques de l’Université de Montpellier, du CNRS et de l’Ifremer, a démontré l’influence prédominante de l’environnement sur la composition en traits et met en avant les rôles écologiques universels assurés par les poissons récifaux à travers les océans. Ces résultats, publiés dans PNAS, le 16 mars 2021, pourraient amener à repenser la stratégie de conservation des espèces.
Les résultats de cette étude sont le fruit de travaux réalisés par des chercheurs du projet Reef-futures, financé grâce au programme BiodivScen du réseau européen BiodivERsA, dont la Fondation pour la recherche sur la biodiversité assure la coordination et le secrétariat.
Qu’est-ce qui détermine le fonctionnement d’un écosystème ? Si l’on a longtemps considéré cette question en tenant compte de la diversité des espèces qui le compose, on sait aujourd’hui que c’est surtout la diversité des traits portés par ces espèces qui détermine le fonctionnement des écosystèmes. Les traits ? « Ce sont leurs caractéristiques morphologiques, physiologiques ou comportementales. La distribution globale de ces traits, qui est influencée par l’environnement et par l’évolution, reste mal connue à travers les océans », explique David Mouillot, chercheur au laboratoire Marbec*. Une connaissance d’autant plus importante que les traits des espèces sont désormais reconnus comme étant les principaux acteurs du fonctionnement des écosystèmes et de la réponse aux changements globaux. Publiée le 16 mars dans la revue PNAS, l’étude impliquant également Fabien Leprieur (UM), Sébastien Villéger (CNRS) et Arnaud Auber (Ifremer), démontre l’influence prédominante de l’environnement sur la composition en traits des écosystèmes récifaux.
Quelques minutes seulement vous seront nécessaires pour parcourir les quatre parties de cette enquête qui questionne différents aspects de nos perceptions dont notamment, les émotions induites via des photographies de paysages.
L’enquête s’intéresse à la fois à la nature dans laquelle nous vivons mais également celle à transmettre, à préserver.
Ses principaux objectifs sont de :
Cette enquête aura cours jusqu’au congrès UICN en septembre prochain. Une partie des résultats sera diffusée d’ici la fin de l’été 2021 et une restitution finale des résultats sera publiée en 2022. Merci pour vos réponses et n’hésitez pas à relayer au plus grand nombre.
Ce projet à été élaboré grâce à la mobilisation des membres du club 5, en particulier Manuelle Rovillé (Les petits débrouillards), Dupuis Louis (Apesa), Hélène Leriche (Orée)et Alix Cosquer (Cefe Cnrs).
Une équipe de recherche internationale cartographie pour la première fois les zones océaniques qui, si elles étaient protégées, permettraient d’atténuer les effets du changement climatique, de préserver la biodiversité et de permettre une meilleure productivité des pêcheries. Ces travaux font l’objet d’une publication dans la revue Nature. Ils sont le fruit de la collaboration de 26 scientifiques et impliquent des chercheurs de l’Université de Montpellier et de l’Ifremer, avec la participation du CNRS. Ce travail a été en partie financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), EDF et la fondation Total, au travers des projets de recherche Free et Pelagic du Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) de la FRB.
Cette nouvelle étude, la plus complète à ce jour, est publiée aujourd’hui et propose une solution pour relever les défis les plus urgents de l’humanité. Elle démontre qu’une protection bien ciblée des océans pourrait à la fois contribuer à un meilleur approvisionnement en ressources alimentaires marines, fournir une solution naturelle et peu onéreuse pour lutter contre le changement climatique, et enfin davantage protéger la biodiversité menacée.
Consultez le communiqué complet
Cette nouvelle étude, la plus complète à ce jour, est publiée aujourd’hui et propose une solution pour relever les défis les plus urgents de l’humanité. Elle démontre qu’une protection bien ciblée des océans pourrait à la fois contribuer à un meilleur approvisionnement en ressources alimentaires marines, fournir une solution naturelle et peu onéreuse pour lutter contre le changement climatique, et enfin davantage protéger la biodiversité menacée.
L’équipe scientifique a identifié des zones qui, si elles étaient protégées, permettraient de sauvegarder plus de 80 % des habitats d’espèces marines menacées et d’augmenter les captures annuelles de plus de huit millions de tonnes par rapport aux débarquements mondiaux actuels. L’étude est également la première à quantifier les émissions de dioxyde de carbone dans l’océan par le chalutage, une pratique de pêche très répandue – et elle révèle que le chalutage rejette des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère chaque année, un volume similaire à celui émis par le trafic aérien mondial.
“La vie océanique est en déclin dans le monde entier en raison de la surpêche, de la destruction des habitats et du changement climatique. Pourtant, seulement 7 % de l’océan mondial est actuellement protégé”, déclare le Dr Enric Sala, explorateur au sein de la National Geographic Society et auteur principal de la publication. “Dans cette étude, nous avons mis au point une nouvelle méthode pour identifier les zones qui, si elles sont fortement protégées, engendreraient une meilleure production alimentaire tout en préservant la vie marine et en réduisant les émissions de CO2“, ajoute-t-il. “Il est clair que l’humanité et l’économie bénéficieront d’un océan plus sain. Nous pouvons concrétiser ces avantages rapidement si les pays travaillent ensemble pour protéger au moins 30 % de l’océan mondial d’ici 2030.”
Pour identifier ces zones prioritaires, les scientifiques se sont notamment focalisés sur les aires marines non protégées et y ont évalué le degré d’impact des activités humaines. Puis, ils ont estimé le niveau d’impact positif qui pourrait découler de la protection de ces zones. Ils ont ensuite mis au point un algorithme permettant d’identifier les zones où des mesures de protection seraient les plus avantageuses pour générer des bénéfices multiples : protéger la biodiversité, augmenter la production de ressources alimentaires marines et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces zones sont identifiables sur des cartes globales (cf. figure) qui pourront concrètement servir de guide aux gouvernements afin que ces derniers puissent mettre en pratique leurs engagements de protection de la nature. L’étude offre ainsi un cadre inédit permettant aux pays de décider des zones à protéger en fonction de leurs priorités nationales.
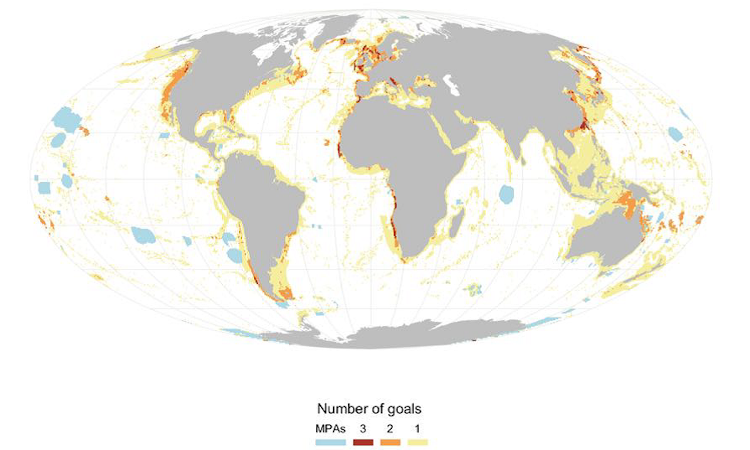
Figure : Répartition des zones pouvant générer des bénéfices multiples (goals) si des mesures de protection strictes y étaient mises en place (bénéfices : protéger la biodiversité, augmenter la production de ressources alimentaires marines et diminuer les émissions de gaz à effet de serre). (Source : Sala et al, 2021)
Seul impératif, il faut qu’au moins 30 % des océans soient protégés pour qu’ils puissent offrir de multiples avantages à l’humanité. Cette étude scientifique pourrait servir de référence pour la 15e conférence des Nations Unies sur la convention sur la diversité biologique, qui aura lieu à Kunming (Chine) en fin d’année 2021 et dont une des cibles clé, serait de protéger 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030 (objectif “30×30”). “Les solutions présentant de multiples avantages sont attrayantes tant pour les citoyens que pour les dirigeants. Notre approche pionnière leur permet d’identifier les zones à protéger afin de faire face aux enjeux majeurs de l’humanité : la sécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de biodiversité”, a déclaré le Dr. Sala.
[1] Biodiversité marine, exploitation et conservation (MARBEC, CNRS/Ifremer/IRD/Université de Montpellier)
Pour aller plus loin... les solutions enjeu par enjeu et des citations supplémentaires
Quels enseignements tirer de cette pandémie qui questionne nos manières de vivre et de travailler, notre définition du progrès, notre manière d’appréhender la part sauvage du monde et aussi l’Autre, dont les activités aux quatre coins du monde impactent notre vie ?
Un an plus tard, la conférence « Une seule santé, en pratique ? » organisée par l’ENSV-FVI VetAgro Sup en collaboration avec France Nature Environnement (FNE), la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), l’Association Santé Environnement France (ASEF), Humanité et Biodiversité (H&B), la Fédération des Syndicats Vétérinaires de France (FSVF), alimentera les réflexions autour de cette crise : Peut-on anticiper et prévenir les pandémies ? Comment s’engager et être acteur.ric.e d’une transformation des modèles de sociétés ? Économie, préservation de la santé et de l’environnement sont-ils conciliables ?
En tant que crise, la Covid-19, comme le dernier épisode de grippe aviaire, a éclairé comme rarement les défis à venir qui nous obligent à repenser les liens entre notre santé, celle des autres espèces vivantes et celle des écosystèmes. Penser globalement la santé du vivant amène à reconsidérer nos systèmes de prévention, de soin et de santé, nos économies (notamment agricoles), notre rapport à l’environnement et aux milieux, mais aussi l’action publique et ses frontières.
Organisées en visioconférence par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), en partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la Transition écologique, ces Rencontres visent à rassembler en ateliers différents acteurs (chercheurs, responsables de politiques publiques, acteurs de terrain, etc.) afin d’élaborer une série de recommandations grâce à une méthodologie basée sur la démarche prospective.
Pour cette édition, trois thèmes ont été identifiés :
Les recommandations issues de ces échanges devraient être publiées dans les mois à venir, à l’instar de celles issues des Rencontres de 2018 et 2017. Nous vous invitons à découvrir la vidéo d’ouverture de l’édition 2020.
Consulter les recommandations des rencontres précédentes :
Bonne nouvelle pour la biodiversité marine de la mer du Nord ! Alors que la biodiversité mondiale connait une crise majeure [1], une étude publiée la semaine dernière dans Proceedings of the Royal Society B montre que l’abondance de la plupart des espèces présentant des stratégies écologiques originales vivant en mer du Nord augmente à mesure que la pression de la pêche diminue et que les océans se réchauffent.
La résistance et la résilience des écosystèmes marins face au changement climatique et aux activités humaines sont des préoccupations majeures, notamment car ces écosystèmes assurent toute une série de services essentiels à l’Homme. La pêche par exemple permet de nourrir plus de 10 % de la population mondiale. Le maintien des stocks halieutiques constitue donc aujourd’hui un défi majeur face à une demande accrue. Optimiser la gestion de la pêche est plus que jamais indispensable et nécessite de mieux connaître la réponse des communautés de poissons face aux diverses variations de leur environnement, qu’elles soient d’origine anthropique ou naturelle.
Coordonnée par des chercheurs français et américains et co-financée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans le cadre de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) et par le groupe Électricité de France (EDF), cette étude apporte des éléments de réponse en se basant sur un travail de synthèse conséquent, rassemblant 33 ans d’enquêtes scientifiques sur l’ensemble de la mer du Nord ! L’objectif ? Caractériser et comprendre la dynamique des communautés de poissons de la mer du Nord dans un contexte de réchauffement des eaux et de réduction progressive de l’intensité de pêche [2].
L’enjeu de l’originalité fonctionnelle (ou de la diversité des fonctions)
L’équipe de chercheurs s’est notamment intéressée aux espèces originales de par leurs caractéristiques biologiques et écologiques que sont les espèces « fonctionnellement distinctes ». Pour cela, elle a étudié les données issues de campagnes scientifiques et les caractéristiques écologiques des espèces de poissons vivant en mer du Nord : leur régime alimentaire, leur âge à maturité sexuelle, la taille de leurs œufs, leur positionnement dans la colonne d’eau, etc. – autant d’éléments qui donnent des indications sur le rôle écologique de ces espèces dans leur écosystème. Pour ce travail, les chercheurs sont partis du principe que les espèces fonctionnellement distinctes – c’est-à-dire les espèces ayant des caractéristiques uniques comme, par exemple, une maturité sexuelle très tardive ou un régime alimentaire particulier par rapport aux autres espèces – peuvent soutenir des rôles écologiques importants et potentiellement irremplaçables, et ainsi contribuer de manière disproportionnée au fonctionnement des écosystèmes.
En conséquence, les chercheurs distinguent à la fois des espèces fonctionnellement distinctes – par exemple le requin-hâ (Galeorhinus galeus) ou la grande castalogne (Brama brama) – et des espèces fonctionnellement communes – par exemple le rouget barbet (Mullus surmuletus) ou le grondin gris (Eutrigla gurnardus). Les chercheurs ont aussi montré que les espèces fonctionnellement distinctes se caractérisent par une maturité sexuelle tardive, une progéniture peu nombreuse et des soins parentaux importants, beaucoup étant des requins et des raies qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire marine.
Les résultats
Durant ces 30 dernières années, l’abondance de la plupart des espèces étudiées a augmenté, et ce, principalement en raison d’une pêche moins intense. Plus précisément, c’est principalement dans le sud de la mer du Nord, là où la pêche était historiquement la plus intense, que l’abondance des espèces fonctionnellement distinctes a le plus augmenté. C’est une bonne nouvelle pour les écosystèmes marins et une démonstration que les efforts de limitation des pressions liées à la pêche finissent par payer, surtout pour les espèces les plus fonctionnellement distinctes qui sont généralement non ciblées par les pêcheries mais malgré cela très sensibles à la pêche suite aux prises auxiliaires (voir figure).
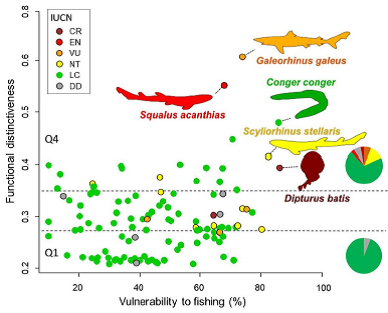
Figure : Les espèces ayant les caractéristiques les plus originales, et étant donc les plus fonctionnellement distinctes, sont les plus vulnérables face à la pêche, certaines d’entre elles étant aussi parmi les plus menacées selon l’UICN. Le statut UICN est représenté par couleur (CR = en danger critique d’extinction, rouge foncée; EN = en danger, rouge; VU = vulnérable, orange; NT = quasi-menacée, jaune; LC = préoccupation mineure, vert; DD = données insuffisantes, gris)
Nous devons cependant poursuivre nos efforts vers une gestion durable de ces milieux fragiles, notamment parce que parmi les espèces les plus distinctes, certaines d’entre elles sont considérées comme menacées d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ont vu leur abondance diminuer au cours des 30 dernières années en mer du Nord, comme le pocheteau gris (Dipturus batis) et l’aiguillat commun (Squalus acanthias).
Enfin, l’équipe de chercheurs souligne l’importance de l’inclusion d’une composante fonctionnelle dans les plans de gestion pour permettre d’assurer une conservation plus pertinente des espèces et des écosystèmes.
[1] Dans son rapport de 2019, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) évoque près d’un million d’espèces animales et végétales menacées d’extinction si aucune mesure n’est prise pour freiner cette tendance.
[2] La réduction progressive de l’intensité de la pêche s’est faite suit à la mise en place, dans les années 1990, d’une réglementation basée sur l’application de quotas en vue d’une exploitation durable.
Connaître le réseau alimentaire d’un écosystème signifie comprendre son architecture, ses flux de matière et d’énergie, et finalement permet de mieux le protéger. Cependant, pour les systèmes très riches, comme les forêts primaires ou les récifs coralliens, nous ne connaissons pas encore de façon globale l’ensemble des relations alimentaires entre espèces.
Sur la base de l’arbre de la vie, qui décrit les relations évolutives entre espèces, une équipe de recherche a montré que de nouveaux algorithmes d’apprentissage automatique permettent de prévoir de façon assez précise l’ensemble des relations alimentaires chez les poissons de récifs.
Cette étude, à laquelle des scientifiques du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), de l’IRD, de l’Institut méditerranéen d’océanologie (M.I.O) et du Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ont contribué, est parue dans le numéro de Janvier 2021 de PLoS Biology.
Découvrez l'article publié par le CNRS
Parravicini V, Casey JM, Schiettekatte NMD, Brandl SJ, Pozas-Schacre C, Carlot J, et al. (2020) Delineating reef fish trophic guilds with global gut content data synthesis and phylogeny. PLoS Biol 18(12): e3000702. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000702
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) est une structure de recherche au rayonnement international dont l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité. Localisé à Montpellier, il accueille chaque année de nombreux chercheurs, issus de tous les continents.
Ces Rencontres visent à rassembler en ateliers différents acteurs (chercheurs, responsables de politiques publiques, acteurs de terrain, etc.) afin d’élaborer une série de recommandations grâce à une méthodologie basée sur la démarche prospective.
Pour cette édition, trois thèmes ont été identifiés :
Les recommandations issues de ces échanges devraient être publiées dans les mois à venir, à l’instar de celles issues des Rencontres de 2018 et 2017. Nous vous invitons à découvrir la vidéo d’ouverture de l’édition 2020.
À l’occasion de la 2e édition des prix Jeune chercheur, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité vous présente les 13 jeunes chercheuses et chercheurs récompensés et leurs sujets d’étude aussi passionnants que différents, tous faisant avancer la recherche sur la biodiversité.
Découvrez les lauréates et lauréats ainsi que les partenaires des prix Jeune chercheur 2020 en vidéo !
Dans le cadre de l’appel à projets FRB-Cesab / France Filière Pêche, le projet Maestro a été retenu par le comité de pilotage et de sélection du Cesab.
Maestro est un projet porté par Arnaud AUBER et Camille ALBOUY, tous deux affiliés à l’Ifremer, qui s’intéressera aux effets du changement climatique sur les communautés marines exploitées.
Le projet sera basé sur l’analyse et la synthèse de données existantes, ainsi que la modélisation des effets des changements climatiques sur la biodiversité des stocks halieutiques européens et les pêcheries associées (Atlantique nord-est et Méditerranée). Il s’agira notamment de contribuer à mieux comprendre la réponse de la biodiversité des ressources halieutiques et des pêcheries dans le contexte des changements climatiques, pour aider à mettre en place des mesures de gestion des pêches adaptative.
Connaissez-vous le safoutier ? Et le plancton diazotrophe ? Imaginiez-vous que les câbles sous-marins interagissent avec la biodiversité marine ? Avez-vous déjà entendu parler d’ethnopharmacologie ?
Pour cette deuxième édition, 54 candidatures ont été reçues, puis évaluées par le Conseil scientifique de la FRB, avant d’être transmises aux partenaires financeurs qui ont pu choisir leurs lauréats : 7 jeunes chercheuses et 6 jeunes chercheurs.
La cérémonie ne pouvant se tenir en raison des conditions sanitaires actuelles, partenaires et lauréats se présenteront dans de courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux de la FRB entre le jeudi 10 et le mardi 15 décembre.
Cette publication retrace les principaux atouts et forces des sciences participatives tout en détaillant les bonnes pratiques et ressources à mobiliser dans ce domaine.
Ce Citizen Science Toolkit (en anglais) a été développé par un groupe composé de scientifiques et d’experts des sciences participatives, suite à un atelier organisé par BiodivERsA à Bruxelles en avril 2019.
Pour l’édition 2020, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité a consacré sa Journée FRB à la thématique des aires protégées.
Cet événement a permis d’expliciter les bénéfices écologiques et aussi socio-économiques des aires protégées et constitué un espace de dialogue entre chercheurs, décideurs politiques et acteurs de la société.
Les présentations des intervenants sont disponibles sur la page internet de l’événement dans la rubrique “ressources téléchargeable”. Les vidéos des différentes interventions seront bientôt en ligne sur le site internet et la chaîne Youtube de la Fondation.
Après la sortie du rapport alarmant de l’Ipbes sur l’état de la biodiversité mondiale, l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent et rythmée par une succession de rapports alertant sur la situation critique de la biodiversité. Ce contexte inédit a mis en lumière le rôle que peuvent avoir les aires protégées pour ralentir l’érosion de la biodiversité et réduire les risques de zoonoses ou d’épidémies.
Les aires protégées sont-elles efficaces ?
Le seront-elles demain ?
Facilitent-elles l’adaptation du monde vivant au changement climatique ?
Quels en sont les bénéfices socio-économiques ?
Comment concilier activités humaines et aires protégées ?
Quel(s) modèle(s) économiques adopter ?
En 2020, les aires protégées, tout statut confondu, avoisinent les 16 % de la surface de la planète. Les objectifs discutés pour la préparation des prochains grands rendez-vous internationaux ambitionnent d’atteindre 30 % de la planète d’ici 2030. Si par définition ces aires sont protégées des activités humaines, de manière partielle ou plus rarement totale, le maintien, l’extension ou la création de nouvelles aires protégées se heurte à des intérêts socio-économiques multiples.
L’évaluation du niveau de protection nécessaire pour atteindre les objectifs fonctionnels sur le plan écologique de ces espaces est donc indispensable.
Les présentations des intervenants sont disponibles dans les ressources téléchargeables.
Contre la paroi du quai, des plongeurs font descendre dans les profondeurs trois murs végétaux de roselières de 150 mètres carrés. Ces herbiers artificiels reproduisent les habitats des espèces marines locales en imitant les caractéristiques des herbiers de posidonie méditerranéens. Ils ont été conçus pour abriter les juvéniles de plusieurs espèces locales de poissons. Au pieds de ces herbiers, des blocs de bétons, réalisés en impression 3D, sont accrochés pour recréer des cavités dans lesquels les poissons devenus un peu plus grands s’abriteront. Marc Bouchoucha, responsable du projet et membre du laboratoire Environnement Ressources Provence-Azur-Corse de l’Ifremer explique : « Les ports ont rarement été perçus comme des écosystèmes, ils ont été très souvent envisagés sous l’angle économique ou culturel, mais peu sous l’angle écologique. Or, ce que nous constatons, c’est qu’ils ont majoritairement été construits sur des petits fonds côtiers abrités, qui ont, pour les poissons, des fonctions écologiques très importantes. »
Le cycle de vie des poissons est en effet tel qu’ils pondent au large, voient leurs œufs flotter et être portés par les courants, puis éclore. Au niveau des côtes, les larves trouvent abri dans les herbiers. Les juvéniles s’y développent et, avant d’atteindre le stade adulte, quittent les roselières pour s’abriter, un peu plus bas, dans de petits rochers. Une fois arrivés à maturité, les poissons rejoignent le large pour y accomplir le reste de leur cycle.
« Aujourd’hui, ce cycle de vie est particulièrement bousculé par les taux d’artificialisation du pourtour méditerranéen qui ne cesse de croitre depuis les années 1950. Dans certaines zones comme Monaco, on atteint même des taux d’artificialisation à 90 % souligne Marc Bouchoucha. »
Le chercheur et son équipe ont donc pour objectif de limiter l’impact de l’artificialisation sur le cycle de vie des poissons en réparant certaines fonctions écosystémiques dégradées . « Mais avant cela, il a fallu nous assurer que les conditions environnementales étaient satisfaisantes ». Une attention particulière a été portée à la contamination chimique en Méditerranée. « Sur ce point, les réseaux de surveillance et les études mis en œuvre par l’Ifremer sur les masses d’eau côtières au cours des 20 dernières années ont montré que la tendance globale est à l’amélioration. » Les indicateurs sont donc « au vert » : pas de hausse significative des niveaux de contamination ; des niveaux constants en contaminants et inférieurs aux normes de qualité environnementale pour la grande majorité des sites suivis ; certes il reste quelques foyers de contamination historique dans certains secteurs identifiés, mais globalement les efforts d’assainissement des dernières décennies ont porté leurs fruits. « Les conditions étaient donc réunies pour restaurer efficacement le milieu. »
En s’inspirant des habitats naturels, la société Seaboost a recréé les habitats des juvéniles. Pour s’assurer de leur efficacité, les scientifiques ont prévu de réaliser des suivis à grande échelle. Ceux-ci sont effectués à différents niveaux. Tout d’abord dans les ports, pour s’assurer que ces habitats ne soient pas colonisés par des espèces envahissantes issues des bateaux provenant du monde entier. Puis sur les espèces elles-mêmes, pour comprendre comment ces populations s’adaptent à ce milieu pollué et sonore. Enfin, dans les zones naturelles, pour voir comment les poissons se développent : «Nous devons pouvoir scientifiquement prouver que de telles installations contribuent à l’amélioration des populations naturelles, souligne Marc Bouchoucha ». Tous les moyens sont mobilisés pour assurer le suivi « On a installé à demeure des caméras sur les récifs pour filmer en continu les poissons, on a couplé cela avec des logiciels de reconnaissance automatique issus de l’intelligence artificielles pour nous permettre d’identifier et de compter les poissons. L’ADN environnemental est aussi utilisé pour étudier la biodiversité difficilement observable à l’œil nu, comme les espèces dites cryptiques qui, sur le plan morphologique, ne présentent aucune différence, mais qui, d’un point de génétique, présentent des différences notables. »
Dans les années à venir, d’autres ports devraient mettre en place ces nurseries de poisson. Cette nouvelle est accueillie avec prudence par Marc Bouchoucha : « La restauration est un outil qui ne doit pas servir à justifier la dégradation d’habitats naturels. Il est important de rappeler qu’elle est en général utilisée lorsque l’on n’a plus d’autres solutions. La protection doit toujours primer sur la restauration. »
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a pour mission de favoriser les activités de recherche sur la biodiversité en lien avec les acteurs de la société. Susciter l’innovation, développer et soutenir des projets, diffuser les connaissances et mobiliser l’expertise sont au coeur de ses actions. Elle accueille par ailleurs le secrétariat scientifique du comité français pour l’Ipbes, la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. À ce titre, elle est chargée de relayer les travaux de la Plateforme au niveau national. La FRB travaille ainsi avec son Conseil d’orientation stratégique (Cos), regroupant plus de 240 structures (entreprises, syndicats, ONG, collectivités territoriales, etc.), afin que les acteurs nationaux s’approprient les messages de l’Ipbes et pour rapprocher les conclusions scientifiques de leurs préoccupations opérationnelles. La Fondation s’est ici associée à ORÉE, association multi-acteurs pour l’environnement membre de son Cos et comptant plus de 180 membres.
Ainsi est née la présente publication, fruit d’un long travail auprès d’acteurs français. Elle fournit un panorama des mesures pour la biodiversité mises en oeuvre au niveau non-étatique, alors que les acteurs sont de plus en plus sollicités pour rendre des comptes sur leurs engagements, notamment en 2020 dans le cadre de la préparation de la Cop 15 de la Convention sur la diversité biologique.
La publication est consultable dans les ressources téléchargeables.
L’équipe de recherche a donc étudié les différentes caractéristiques des poissons de récifs cryptobenthiques (vivant cachés sur les fonds marins) vivant dans les récifs coralliens les plus chauds et extrêmes du monde situés dans le sud du golfe Persique et ceux voisins, mais un peu plus cléments, du golfe d’Oman afin d’en savoir plus sur les effets de ces changements environnementaux notamment sur l’assemblage et le fonctionnement des communautés de poissons des récifs coralliens.
Pourquoi trouve-t-on certaines espèces dans un milieu donné alors que d’autres, qui leur ressemblent, en sont absentes ? Comment l’assemblage des espèces présentes affecte les dynamiques des processus écologiques de ce milieu ?
Ce sont à ces questions cruciales pour la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques qu’a souhaité répondre une équipe de chercheurs, dont les résultats ont été publiés dans Nature communications le 31 juillet 2020. Plus précisément, leur étude s’est intéressée aux organismes tropicaux ectothermes1 considérés comme vulnérables aux changements environnementaux. En effet, les effets de ces changements, notamment sur l’assemblage et le fonctionnement des communautés de poissons des récifs coralliens, sont aujourd’hui encore largement méconnus. L’équipe de recherche a donc étudié les différentes caractéristiques des poissons de récifs cryptobenthiques2 vivant dans les récifs coralliens les plus chauds et extrêmes du monde situés dans le sud du golfe Persique3 et ceux voisins, mais un peu plus cléments, du golfe d’Oman.
Malgré une composition benthique et une couverture corallienne comparables, cette étude révèle que le nombre d’espèces de poissons du golfe Persique est divisé par deux et le nombre d’individus de ce même golfe par quatre, par rapport à celui d’Oman. Cette importante différence semble être due à des carences énergétiques chez les poissons : la disponibilité des proies est différente dans les environnements extrêmes, les températures y sont plus élevées et affectent par exemple la disponibilité en oxygène dans l’eau, etc. Des conditions environnementales plus difficiles, telles qu’attendues pour la fin du 21e siècle, pourraient donc fortement perturber la structure et la productivité des poissons de récifs coralliens indépendamment du déclin des récifs coralliens.
[1] Les animaux ectothermes sont ceux qui ne produisent pas de chaleur interne (insectes, reptiles, poissons, etc.).
[2] Les poissons cryptobenthiques sont ceux vivant cachés sur les fonds marins (du latin crypto : « se cacher » et benthos : fond, profondeur).
[3] L’article réfère au golfe Arabique ou Arabo-Persique mais les auteurs de la synthèse ont choisis d’utiliser le terme choisi par l’ONU, à savoir golfe Persique
Consulter la synthèse complète dans les ressources téléchargeables ci-dessous.
Au travers de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), la FRB finance deux post-doctorants jusqu’à 18 mois, pour réaliser un travail de revue systématique, mobilisant cartographie systématique, évaluation critique et synthèse narrative du corpus de textes sélectionnés, en vue de la rédaction d’un article de synthèse destiné à une revue scientifique internationale.
Le projet pourra aller soit jusqu’à une analyse lexicographique aboutie, soit jusqu’à l’extraction des données statistiques du corpus et leur analyse (méta-analyse).
Date de clôture des pré-propositions : 9 septembre 2020, 23:59 CEST
Toutes les informations sont disponibles sur la page de l’appel.
En 2018, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et son Conseil scientifique ont créé le Prix Jeunes Chercheurs, en lien avec son Conseil d’orientation stratégique (Cos), pour accompagner les jeunes chercheur.euse.s qui contribuent significativement aux sciences de la biodiversité.
Toutes les informations sur l’édition 2020 ainsi que les modalités de candidature sont disponibles sur la page de l’appel.
Les changements climatiques vont impacter durablement les océans et les mers à l’échelle globale. Les impacts de ces changements sur les pêches maritimes sont devenus une préoccupation prioritaire.
Dans ce cadre, en partenariat avec France Filière Pêche, la FRB appelle la communauté scientifique à soumettre des projets au Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), basés sur l’analyse et la synthèse de données existantes, ainsi que la modélisation des effets des changements climatiques sur la biodiversité des stocks halieutiques européens et les pêcheries associées (Atlantique nord-est et Méditerranée).
Il s’agira notamment de contribuer à mieux comprendre la réponse de la biodiversité des ressources halieutiques et des pêcheries dans le contexte des changements climatiques, pour aider à mettre en place des mesures de gestion des pêches adaptative.
Date de clôture des pré-propositions : 11 juin 2020, 13:00 (UTC+1)
Toutes les informations sont disponibles sur la page de l’appel.
Le carbone bleu correspond au carbone séquestré par les écosystèmes côtiers végétalisés. Les marais salés, les mangroves, ou encore les herbiers, sont autant d’écosystèmes susceptibles de capter le carbone sur le court terme, environ une dizaine d’années, dans leur biomasse et sur des temps encore plus longs, des milliers d’années, dans leurs sédiments. Contrairement aux sols terrestres, ces sédiments côtiers ont tendance à s’étendre avec l’augmentation du niveau de la mer On constate donc que la séquestration de carbone par les sédiments et les végétaux augmentent au cours du temps, en particulier lorsque ces écosystèmes sont sains et en bonne santé.
On sait que les marais salés, les mangroves ou les herbiers stockent le carbone 10 à 20 fois plus que les forêts tempérées ou boréales. Lorsque que les forêts séquestrent moins de 10 g de CO2 par mètre carré et par an, les écosystèmes côtiers en retiennent 100 à 200 g. Néanmoins ces écosystèmes représentent une partie moins importante de la surface du globe que les océans ou les forêts. Si certaines études indiquent qu’on obtient un stockage de carbone équivalent aux forêts, les travaux se poursuivent pour mieux quantifier cette séquestration et la part du carbone relâchée vers l’atmosphère.
C’est extrêmement complexe. Nous travaillons avec d’autres scientifiques à la meilleure compréhension du rôle des zones côtières dans ce cycle du carbone. La principale difficulté vient du fait que nous avons une très forte hétérogénéité spatiale et temporelle. Les échanges de carbone interviennent au niveau de multiples interfaces terrestre-aquatique. Si on sait par exemple que l’océan côtier représente un puits de carbone incontestable grâce à sa production primaire phytoplanctonique, les estuaires émettent, quant à eux, d’importantes quantités de CO2 vers l’atmosphère du fait de l’intense minéralisation de la matière organique qui existe dans ces eaux turbides, c’est-à-dire troubles, limitant la photosynthèse. Entre ces écosystèmes, se trouvent les marais et les vasières intertidales1. Là, de multiples échanges horizontaux et verticaux de carbone existent au sein et entre les compartiments terrestre, aquatique et atmosphérique aux échelles du jour et de la nuit, de la marée, de la saison et de l’année. Ces échanges particulièrement complexes et dynamiques ne peuvent alors être appréhendés que de façon intégrative et multidisciplinaire en faisant appel à des équipes de géographes, de géologues ou d’écologues pour mieux préciser leurs statuts de puits ou source de carbone.
Incontestablement si les débats portent sur la qualification des processus et la quantification des échanges, ils ne retirent rien aux services écosystémiques que nous retirons de cette biodiversité. Si son érosion se poursuit, la capacité à capturer efficacement le carbone de l’atmosphère pourrait être compromise, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre et d’intensifier l’acidification des eaux côtières. Malheureusement, ces écosystèmes ne sont pas épargnés par le changement d’usage des terres. D’après les chiffres de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on sait par exemple que chaque année, près de 2 % des mangroves disparaissent et contribuent au relâchement de 120 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Depuis les années 1990, les surfaces des herbiers marins ont diminué de moitié à travers le monde. Ceci est à la fois dû à des pressions anthropiques, mais aussi à une pression de parasitisme. Pour protéger ces zones, un certain nombre d’actions ont été mises en place, comme aux États-Unis sur la côte de Virginie où se trouve le site de South Bay choisi pour faire partie d’un vaste projet de restauration des herbiers initié au début des années 2000. À partir d’un simple vestige découvert dans une baie en bord de mer au large de la côte est, The Nature Conservancy et le Virginia Institute for Marine Science ont diffusé plus de 72 millions de graines pour aider à accélérer la propagation naturelle de la zostère (Zostera marina), qui couvre aujourd’hui 13,5 km2. Une étude publiée dans Plos One a montré que ces prairies sous-marines restaurées devraient accumuler du carbone à un taux comparable à celui mesuré dans les prairies sous-marines naturelles. C’est extrêmement encourageant.
par Thierry Thibaut, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanographie (MIO), Marseille. Travaillant sur le projet Marfor de Biodiversa.
« Si les forêts marines d’algues (kelps) ne jouent pas un rôle direct dans l’atténuation du changement climatique, elles y contribuent largement en permettant à la biodiversité côtière de se maintenir. Comme les forêts terrestres, elles abritent un très grand nombre d’espèces. Les forêts sous-marines de Kelps géants, par exemple en Californie, font plus de 40 mètres de haut et sont considérées comme le plus haut niveau trophique du monde avec ses sept à huit niveaux. Lors de perturbations d’origine naturelle ou antropique , plus la biodiversité est importante, plus l’écosystème a la possibilité de se régénérer. De même, lorsque l’écosystème est peu diversifié, les chances de le voir se reconstituer sont faibles. Ainsi assiste-t-on dans certaines zones abimées à des dénudements presque totaux, à cause d’herbivores comme les oursins qui y prolifèrent. Les forêts marines maintiennent donc de haut niveau de services écosystémiques, dont l’atténuation du changement climatique, en contribuant à préserver les écosystèmes côtiers qui sont pour certains des puits de carbone (herbiers de plantes à fleurs marines). C’est entre autres pour cela qu’il faut les préserver à un moment où on assiste à des déclins dans toutes les mers et tous les océans de ces écosystèmes côtiers, notamment en raison de la destruction irrémédiable des habitats due à la construction de ports, de marinas, parkings, mais aussi au surpâturage des herbivores et à une augmentation des températures. »
_______________
1 Zone au-dessus du niveau de l’eau à marée basse et sous l’eau à marée haute en d’autres termes, des vasières se situant dans le secteur des marées.
Des scientifiques de l’Université de Montpellier, de l’IRD, du CNRS (tous trois membres fondateurs de la FRB) et de l’Université de Nouvelle-Calédonie ont étudié 1 800 récifs coralliens à travers le monde dont 106 en aires marines protégés. Ils se sont intéressés à leur capacité à atteindre simultanément des objectifs de biomasse en poissons commerciaux, d’herbivorie et de diversité fonctionnelle1. Les chercheurs ont démontré que seule l’intégration des récifs isolés très rares dans des aires marines protégées intégrales de type « no-take » permettait d’assurer ces trois objectifs à bon niveau.
Au cours de cette étude, les chercheurs ont également simulé l’effet de la « mise en aire marine protégée intégrale ou partielle » des sites mondiaux sans aucun niveau de protection.
Les résultats montrent que la création ou le renforcement du statut de protection d’aires marines protégées présente des résultats variables en fonction du statut de protection.
D’une part, la création d’aires marines avec une protection intégrale sur les récifs ayant subi des pressions humaines limitées aurait un effet très important sur la biodiversité.
D’autre part, la mise en place d’aires marines protégées partielles pourrait être une étape intermédiaire permettant d’assurer à la fois la poursuite des usages à des fins économiques et de subsistance des populations qui en dépendent et la conservation nécessaires à la protection des écosystèmes.
Enfin, les résultats de ces travaux de recherche soulignent également que la création d’aires marines protégées dans des zones fortement impactées par l’activité humaine est inefficace et ne permet pas d’assurer la restauration de peuplements de poissons ni pour la protection de la biodiversité ni pour la durabilité des activités de pêche.
__________________
1 la biomasse en poissons commerciaux est importante pour les activités liées à la pêche, le potentiel d’herbivorie des poissons sur le récif est une fonction essentielle pour le contrôle des algues et le maintien de l’habitat corallien, la diversité fonctionnelle est une facette essentielle de la biodiversité
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et ses partenaires lancent un appel pour soutenir l’accueil de stagiaires de master 2 dans des laboratoires de recherche français, métropolitains et ultramarins, travaillant sur la biodiversité.
Les équipes lauréates recevront un financement pour la gratification d’une ou d’un stagiaire pour un stage de 4 à 6 mois.
Date limite de soumission : 14 avril 2020, minuit CET (heure de Paris)
Toutes les informations sont disponibles sur la page de l’appel master 2020.
Au travers de la campagne « La science pour un monde durable », découvrez ces pistes, nombreuses, sérieuses et passionnantes, sur lesquelles travaillent les chercheurs français en lien avec les recommandations proposées par l’Ipbes afin d’atteindre les objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies et de nourrir les réflexions en vue de la définition du cadre d’action post 2020 de la CDB.
Chaque mois, la FRB, ses instituts membres fondateurs et l’alliance AllEnvi mettent en avant les solutions de la recherche pour enrayer le déclin de la biodiversité. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre page dédiée. Pour ce premier mois, la thématique abordée est la conservation et la gestion durable du milieu marin.
Consulter les articles de la thématique :
De l’échantillon moléculaire au balayage satellite, les spécialistes du milieu marin déploient un arsenal multi-échelles pour observer et caractériser mers et océans. Avec l’aide des populations et usagers de la mer, ils scrutent en permanence ces étendues salées qui couvrent les deux tiers de la planète. Les données qui en résultent bénéficient à la compréhension et la gestion de nombreuses questions : variation du climat, fonctionnement des écosystèmes, préservation de la biodiversité, gestion des ressources vivantes, lutte contre les facteurs de dégradation…
Mieux identifier les espèces de poissons pour optimiser la gestion des ressources et mieux comprendre leur écologie. Tels sont deux des enjeux du barcoding ADN, l’analyse de fragments ADN permettant de déterminer l’espèce à laquelle appartient un individu. A l’aide de cette approche, une équipe de scientifiques menée par l’IRD vient de produire un nouveau jeu de données de barcodes des poissons récifaux de Nouvelle-Calédonie, complétant une base de données commune aux océans Indien et Pacifique. Ils ont identifié 805 espèces sur trois sites différents : Île de La Réunion et Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française.
Dans un monde en mutation rapide, nous devons identifier les zones qui doivent être protégées contre les menaces actuelles et futures. L’enjeu est important, notamment pour la définition d’aires marines protégées, pourtant cette identification est difficile, particulièrement pour l’océan le plus inaccessible : l’océan Austral, en Antarctique. Les résultats d’une étude publiée cette semaine dans la revue Nature, décrivent une nouvelle solution à ce problème, permise par l’utilisation de données de suivi des oiseaux et des mammifères marins.
Le projet qui a permis la réalisation de cette étude a été mené par le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), avec le soutien de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans son centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) au travers du projet RAATD, et du WWF-RU.
Le SCAR a fait appel à son vaste réseau de chercheurs travaillant sur l’Antarctique pour rassembler les données existantes sur le suivi des prédateurs de l’océan Austral. Une énorme base de données, en accès libre, a ainsi été créée avec les suivis de plus de 4 000 individus de 17 espèces différentes, recueillis par plus de 70 scientifiques dans le cadre de 12 programmes en Antarctique.
Cette solution repose sur un principe simple : les animaux se déplacent depuis leur site de reproduction jusqu’aux zones où ils trouvent de la nourriture. Ainsi, en identifiant les zones de l’océan Austral où les prédateurs se rendent le plus souvent, on peut en déduire où se trouvent leurs proies. Par exemple, les baleines à bosse se déplacent dans des endroits où elles peuvent avoir accès au krill, tandis que les éléphants de mer et les albatros se déplacent dans des endroits où ils peuvent trouver poissons, calmars ou autres proies. Si tous ces prédateurs et leurs diverses proies se trouvent en un même endroit, alors cette zone présente à la fois une grande biodiversité et une grande abondance d’espèces, ce qui en fait une zone de grande importance écologique.
Ce projet a été mené par le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), avec le soutien de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans son centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) au travers du projet RAATD, et du WWF-UK. Le SCAR a fait appel à son vaste réseau de chercheurs travaillant sur l’Antarctique pour rassembler les données existantes sur le suivi des prédateurs de l’océan Austral. Une énorme base de données, en accès libre, a ainsi été créée avec les suivis de plus de 4 000 individus de 17 espèces différentes, recueillis par plus de 70 scientifiques dans le cadre de 12 programmes en Antarctique.
Cependant, il est impossible de suivre toutes les espèces à partir de tous leurs sites de reproduction : une simple carte fournirait donc une représentation biaisée de la distribution des animaux. Pour surmonter ce problème, des modèles statistiques sophistiqués ont été développés afin d’estimer les mouvements en mer des différentes espèces de prédateur, depuis leurs sites de reproduction. Ces estimations, combinées aux données obtenues sur les 17 espèces suivies, ont permis d’élaborer des cartes représentant les zones utilisées par un ensemble de prédateurs ayant des besoins en proies variés (cf. ci-dessous).
Ces zones d’importance écologique sont en partie couvertes par les aires marines protégées (AMP) existantes (créées dans un but de conservation), ce qui laisse à penser qu’elles sont actuellement aux bons endroits. Pourtant, si on s’intéresse à la façon dont ces zones d’importance écologique sont susceptibles de se déplacer d’ici 2100, d’après les projections des modèles climatiques du GIEC, ces mêmes zones ne se retrouvent plus couvertes par les aires marines protégées. Il est donc nécessaire de commencer à envisager des aires marines protégées dynamiques qui seraient mises à jour au fil du temps en fonction des changements environnementaux, afin d’assurer une protection continue dans le temps et dans l’espace de l’océan Austral et de ses ressources.
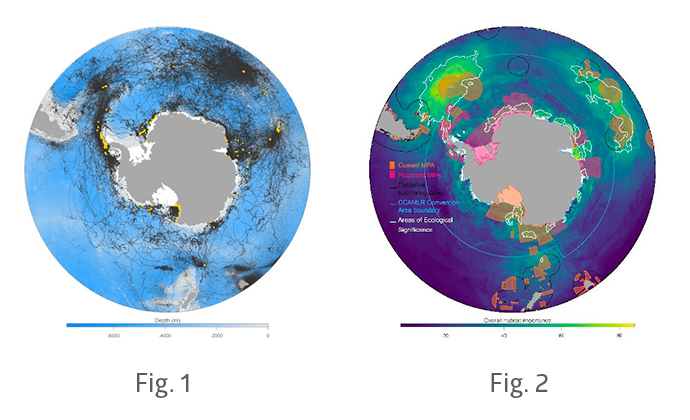
Fig. 1 : Carte de l’océan Austral montrant les données de suivi des mouvements (points noirs) de 4060 individus de 17 espèces de prédateurs marins qui ont été utilisées pour prévoir les zones d’importance écologique. Les points jaunes indiquent les endroits où chaque piste a commencé, autrement dit les sites de reproduction des individus.
Fig. 2 : Carte de l’océan Austral montrant les habitats d’importance écologique définies à l’aide des données de suivi de 17 espèces de prédateurs marins. Les zones présentant les valeurs les plus élevées en termes d’importance écologique sont entourées en blanc, dont deux zones hauturières : une au niveau de la péninsule Antarctique et se projetant sur l’arc de Scott, et l’autre entourant les îles subantarctiques dans le secteur indien de l’Océan Austral. Elles sont mises en rapport avec les aires marines protégées (AMPs) actuelles (en orange) et proposées (en magenta). Sont également indiquées, en noir, les limites des eaux nationales (ou zones économiques exclusives) et la limite de la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique).
Sur environ 1.8 millions d’espèces décrites à ce jour, moins de 250 000 sont marines. Or, les dernières estimations suggèrent que 60 à 80 % de la biodiversité de notre planète se cache en fait sous la surface des océans. Largement méconnue et difficile d’accès, cette biodiversité phénoménale n’échappe pas aux impacts des activités humaines. Pour mieux connaître et donc protéger ces espèces et leurs milieux de vie, l’Ifremer a lancé en 2016 le projet Pourquoi pas les abysses ?. Objectif : accélérer l’inventaire des espèces qui peuplent les grands fonds marins grâce à l’ADN environnemental.
Une étude parue dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment indique que seule 1,4 % de cette surface est en réalité intégralement protégée, alors que les aires intégralement protégées sont considérées comme les moyens de protection les plus efficaces. Selon Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, et coauteur de l’article, « on constate à la fois dans la littérature scientifique et sur le terrain que non seulement les aires marines intégralement protégés sont minoritaires, mais qu’en plus, sur toutes celles qui existent, une infime minorité fonctionne. » Pour le chercheur, l’explication est simple : « les aires protégées qu’elles soient marines ou terrestres sont aujourd’hui trop souvent conçues uniquement sur des pré-requis écologiques, alors qu’elles devraient être pensées également en termes socio-écologiques. » Autrement dit pour protéger la biodiversité, il faudrait avant tout comprendre comment les hommes interagissent avec elle pour trouver les meilleures solutions de préservation. Fort de cette intuition, le chercheur et son équipe ont développé une méthode socio-écologique pour identifier les outils de gestion (dont les aires protégées) les plus à même d’être efficaces.
En pratique, l’aquaculture multi-trophique intégrée consiste à inclure dans les écosystèmes aquacoles des organismes de niveaux trophiques inférieurs, comme de petits invertébrés, capables d’ingérer les rejets organiques, sources de pollution environnementale : « Les effluents d’élevage génèrent des nutriments (carbone, azote et phosphore). Ils peuvent, dans certains cas, s’accumuler dans le milieu et engendrer une réduction de la disponibilité en oxygène néfaste pour les espèces benthiques présentes à proximité. » poursuit la chercheuse. À l’heure où la demande mondiale de produits aquatiques est passée de 9,9 kg par habitant et par an à 18,6 kg en moins d’un demi-siècle, parvenir à un modèle durable devient un enjeu majeur pour le secteur aquacole « d’autant que cet accroissement n’est pas assuré par les pêcheries traditionnelles mais par l’aquaculture » poursuit Myriam Callier.
Afin de limiter les impacts sur l’environnement, l’Ifremer et dix autres instituts de recherche européens ont mené le projet IMTA-Effect. Leur objectif : évaluer les différents systèmes d’intégration des systèmes d’aquaculture multi-trophique intégrée dans des pays aussi différents que la France, le Portugal, la Roumanie et la Grèce. « Nous avons cherché à comprendre comment optimiser la chaine trophique entre le poisson, les microalgues, les mollusques et les détritivores, poursuit Myriam Callier. Nous avons travaillé sur chaque espèce pour bien comprendre sa biologie et son rôle dans les écosystèmes piscicoles. » Le choix de l’espèce extractive à intégrer est évidemment fonction du service de bioremédiation recherché.
Le projet IMTA-Effect s’est notamment concentré sur un ver polychète marin (Hediste diversicolor), détritivore, qui se nourrit des excréments des poissons. « On connait sa biologie, précise la chercheuse. Il vit dans des milieux naturellement riches en matière organique, tolère de faible concentration en oxygène et de fortes variations de température. Il a l’avantage de pouvoir aussi être valorisé comme appât de pêche. Son élevage en aquaculture multi-trophique intégrée pourrait permettre de diminuer son exploitation, car il est lui-même péché dans le milieu naturel. » Par ailleurs, son étude, à la fois réalisée en laboratoire et en milieu contrôlé, a permis de comprendre dans différentes conditions environnementales sa capacité de bioremédiation. « Nous sommes désormais en mesure de dire exactement combien de rejets de poisson le polychète marin peut ingérer au mètre carré. »
La difficulté est que chaque système d’élevage est spécifique. Répondre aux besoins de chaque espèce, surveiller les températures, les changements de saisons sont autant de facteurs à prendre en compte pour harmoniser les écosystèmes. Dans sa forme la plus complexe, un système en aquaculture multi-trophique intégrée peut comprendre jusqu’à quatre compartiments extractifs à équilibrer : les espèces autotrophes (macro et microalgues), les filtreurs (ex. bivalves), les détritivores (ex. polychètes, concombre de mer et autres invertébrés benthiques) et les bactéries. « Les résultats de ces études permettent de paramétrer des modèles qui serviront par la suite à prédire la capacité de bioremédiation de chaque maillon trophique et de tester différents scénarios, comme l’effet d’un changement de température » souligne la chercheuse.
À une échelle plus fine, le chercheur de l’Ifremer Cyrille Przybyla s’est lui intéressé au compartiment des microalgues qui ont pour particularité de purifier l’eau des bassins, mais aussi d’être potentiellement des aliments pour les poissons. Un enjeu majeur lorsque l’on sait que l’aquaculture impacte les stocks de petits poissons sauvages pêchés. Réduits en farine et en huile, ils sont utilisés pour nourrir principalement les poissons des fermes et plus largement certains animaux d’élevages ou domestiques. Pour alléger les pressions sur cette biodiversité marine, de très nombreux instituts de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course pour sélectionner l’algue qui serait en mesure de devenir une source d’alimentation alternative pour le poisson d’élevage. « Notre démarche dans le projet MARINALGAE4Aqua, est tout autre, précise Cyrille Przybyla. Nous avons décidé de laisser faire la nature, en favorisant une polyculture algale naturelle. ». Pour cela, les effluents sont laissés en bassin ouvert permettant à la nature de mettre sa diversité locale au service de l’épuration de l’eau d’élevage et de la nutrition en aquaculture. « Ce n’est pas une seule algue qui vient se développer sur les effluents, mais toute une prairie de microalgues dont la diversité change en fonction des saisons. » Ces microalgues ont néanmoins des valeurs protéiques et lipidiques bien réelles. Cyrille Przybyla et son équipe sont arrivés à récolter 5kg de farine sèche, fertilisée par les effluents sortant des bassins d’aquaculture, qu’ils ont réussi à réinjecter dans l’alimentation du poisson « On a substitué 20% des farines et huiles de poissons dans la composition de l’alimentation des élevages. On est parvenu à améliorer la durabilité de l’aliment en se basant sur le principe de l’aquaculture multi-trophique intégrée, sans qu’il y ait de conséquence sur la croissance et le bien-être des poissons. » L’aquaculture multi-trophique intégrée peut donc se décliner sur le modèle des poupées russes et permettre à la filière aquacole d’opérer sa transition environnementale pour devenir la grande source d’alimentation durable qui participera de façon substantielle à nourrir de 8,5 milliards d’humains en 2030.
_______________
Auteur : Julie de Bouville
Relecteurs : Myriam Callier, Cyrille Przybyla, Hélène Soubelet, Jean-François Silvain, Pauline Coulomb
Des solutions pour enrayer le déclin de la biodiversité existent. De nombreuses équipes de recherche y œuvrent quotidiennement. Chaque mois, de mars à octobre 2020, la FRB, ses instituts membres fondateurs – le BRGM, le Cirad, le CNRS, l’Ifremer, l’Ineris, INRAE, l’IRD, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Université de Montpellier – et l’alliance AllEnvi s’unissent pour valoriser les travaux et résultats des chercheurs qui travaillent sur des solutions et leviers d’action.
Rendez-vous dès mi-mars pour suivre le #ScienceDurable : « La science pour un monde durable ».
Afin de comprendre les enjeux et les risques de cette approche relativement récente de l’exploitation du monde vivant, la FRB a été missionnée par le ministère de la transition écologique et solidaire pour réaliser une veille scientifique et identifier ainsi les menaces et opportunités actuelles du biomimétisme pour la biodiversité. Le rapport issu de ce travail de veille ainsi qu’un résumé sont disponibles dans la rubrique “lire le rapport“.
Le concept de biomimétisme ou bio-inspiration a été théorisé pour la première fois il y a une vingtaine d’année (cf. Janine Benyus : Biomimicry, Innovation Inspired by Nature). L’approche initiale défend une vision qui considère que cette démarche d’innovation « fait appel au transfert et à l’adaptation des principes et stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes, afin de produire des biens et des services de manière durable, et rendre les sociétés humaines compatibles avec la biosphère ».
Le Biomimétisme identifie des solutions naturelles apparues au cours de l’évolution, c’est à dire des fonctions ou des rapports entre structures et fonctions chez les organismes vivants qu’il peut être intéressant de transposer à une fonction d’intérêt humain : sa finalité est de chercher, d’identifier et de d’industrialiser une solution à un problème humain.
Cette démarche est nécessairement interdisciplinaire, entre sciences fondamentales et sciences de l’ingénieur, et demande de la part des acteurs économiques la mobilisation de ressources significatives en matière de recherche et développement (R&D).
Le biomimétisme est la rencontre de plusieurs mondes, l’écologie,
les sciences de l’évolution, la biologie et l’ingénierie,
ou encore une interface entre sciences naturelles et industrie.
L’association Biomimicry Europa, créée en 2006 pour la promotion du biomimétisme, propose de distinguer trois niveaux d’inspiration : les formes biologiques, les matériaux et processus, les interactions.
En matière de recherche et développement, l’Allemagne a longtemps été en tête avec plus de 100 structures de recherche publiques impliquées et dix réseaux territoriaux spécialisés. Le Royaume-Uni et la Suisse sont aussi deux pays fortement impliqués en Europe.
En France, l’implication est plus récente, mais actuellement, plus de 175 équipes de recherche s’intéressent au sujet et plus de 100 entreprises font appel à cette démarche. Plusieurs Groupements de recherche (GDR) et Réseaux thématiques pluridisciplinaires (RTP) génèrent des initiatives structurantes autour de la chimie bio-inspirée, la mécanique des matériaux biologiques ou les micro-technologies inspirées des insectes. Le centre européen d’excellence en biomimétisme (Ceebios), créé en 2012, fédère un nombre croissant de grandes entreprises comme L’Oréal, LVMH, Engie, Vicat, Saint-Gobain, et bénéficie du soutien du ministère de la transition écologique et solidaire.
Les régions les plus impliquées en matière de R&D (compétences académiques) sont l’Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, puis, à un niveau sensiblement équivalent, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Grand-Est.
Le nombre d’aires marines protégées a augmenté de façon exponentielle au cours des dix dernières années afin de répondre aux objectifs internationaux. Cependant, la plupart de ces zones permettent l’extraction de ressources et sont donc désignées comme « aires partiellement protégées » (Partially Protected Area). L’efficacité de ces aires reste encore incertaine en raison des multiples possibilités d’usage qui y sont généralement autorisées.
Dans un article paru dans la revue Frontiers in Ecology and the environment, des scientifiques ont évalué l’efficacité écologique des aires partiellement protégées regroupées selon un système de classification basé sur la réglementation. Cette nouvelle classification permet une différenciation non ambiguë entre les aires protégées, en fonction des usages autorisés.
Les résultats montrent que les zones hautement et modérément protégées présentent une biomasse et une abondance plus élevées d’espèces de poissons commerciales, tandis que l’abondance et la biomasse des poissons dans les zones faiblement protégées différent peu des zones non protégées. Les auteurs soulignent notamment que l’efficacité des zones modérément protégées peut être améliorée par la présence d’une zone adjacente intégralement protégée.
Ainsi, des usages limités et bien réglementés dans les aires partiellement protégées et la présence d’une zone intégralement protégée adjacente confèrent des avantages écologiques dont découlent les avantages socio-économiques.
Consultez la synthèse complète.
Les zones côtières du monde sont de plus en plus soumises à des pressions humaines nécessitant une gestion adaptée et stratégique. L’établissement d’aires marines protégées (AMP) est un outil couramment utilisé pour améliorer la conservation, la sécurité alimentaire et la gestion des pêches. L’étude des conséquences écologiques des aires intégralement protégées (c’est-à-dire des zones sans prélèvement) révèle que l’abondance et la taille des espèces exploitées sont généralement accrues et ce, même au-delà des zones protégées dans certains cas, grâce à un effet de débordement. Par ailleurs, ces aires intégralement protégées permettent le rétablissement des populations et des communautés de poissons et d’autres taxons marins assurant ainsi la préservation de la structure de l’habitat.
La mise en place de zones intégralement protégées a souvent entraîné des conflits entre les enjeux de conservation de la biodiversité et les objectifs socio-économiques, en particulier dans les zones exploitées par de nombreux utilisateurs et soumises à différents types d’usages. Ainsi, l’établissement d’aires partiellement protégées, dans lesquelles certaines activités extractives peuvent être autorisées, est devenue une option favorisée par de nombreux décideurs, car plus facile à mettre en place au vu des objectifs à la fois socio-économiques et écologiques affichés. À la suite des accords et engagements internationaux, de plus en plus d’aires marines protégées sont en cours de création, mais la plupart ne sont que partiellement protégées. Il est donc urgent de déterminer quelles formes de protection partielle peuvent apporter des avantages socio-économiques tout en conservant une pertinence en termes de protection de la biodiversité.
Les aires partiellement protégées dépendent du contexte et leurs réglementations varient en fonction des objectifs de gestion qui vont, à leur tour, affecter leur efficacité écologique.
Un nouveau système de classification des aires protégées en fonction des activités commerciales et récréatives autorisées a été récemment développé (Horta e Costa et al., 2016). Dans ce système, les aires protégées, partielles et intégrales, sont classées en fonction des impacts cumulés des activités autorisées. Il est donc essentiel de comprendre les conséquences écologiques des différents types de protection partielle, celles-ci étant très certainement liées à différents régimes de réglementation. Dans cet article, les chercheurs présentent une nouvelle approche pour étudier et déduire comment une diversité de niveaux de protection partielle peut entraîner différents niveaux d’efficacité écologique. Ils ont également examiné comment les caractéristiques des aires protégées (âge et taille) peuvent influer sur l’efficacité des zones partiellement protégées, ou comment les caractéristiques spécifiques aux aires protégées multi-zones, telles que la présence d’une zone intégralement protégée adjacente, peuvent influer sur l’efficacité de la protection partielle.
« Plus d’un million d’espèces menacées », c’est le chiffre qui a marqué les esprits cette année, au moment de la sortie du rapport de l’Ipbes sur l’état mondial de la biodiversité et des services écosystémiques. Pertes et dégradations d’habitats, surexploitations ou encore pollutions sont autant de pressions induites ou accentuées par les activités humaines qui pèsent aujourd’hui considérablement sur la biodiversité. Le constat est désormais posé et la question de la mesure des impacts de nos activités, qui joue un rôle clé pour passer à l’action, est plus que jamais d’actualité.
Dans un contexte où la France accentue son engagement pour limiter ses impacts négatifs sur la biodiversité, au travers notamment du Plan Biodiversité, et participe à la préparation de la COP15 et de l’agenda post-2020 pour la biodiversité, les différents acteurs de la société ont aujourd’hui besoin d’indicateurs et d’outils de mesure. Les acteurs publics et privés, les décideurs politiques et économiques qui s’engagent, à l’échelle d’un territoire ou d’un pays, à estimer et limiter leurs impacts sur la biodiversité, sont en quête de réponses.
Les Journées FRB 2019 ont été l’occasion d’ouvrir la question de la mesure des impacts des activités humaines sur la biodiversité et d’informer sur des indicateurs et outils de mesure existants, leur utilisation actuelle et explorer ensemble leur potentiel d’appui à la décision en faveur de la biodiversité. Elles se sont tenues sur deux jours : une journée d’ateliers mardi 1er octobre, suivie d’une journée plénière mercredi 2 octobre.
Retrouvez, dans les ressources téléchargeables ci-dessous :
Une publication reprenant l’ensemble du travail effectué autour des journées FRB 2019 devrait voir le jour en 2020.
La FRB a le plaisir d’annoncer la sortie du rapport Biodiversity, a pressing need for action in Oceania, élaboré sous la direction de Claude E. Payri et Eric Vidal, deux chercheurs de l’IRD, et auquel Jean-François Silvain, le président de la FRB, a contribué.
Ce rapport est issu des conclusions des experts et des rapporteurs de l’atelier « Biodiversité en Océanie » qui s’est tenu à Nouméa les 24 et 25 juin derniers. Il a été présenté le 5 septembre à Apia (Samoa) aux ministres de l’Environnement des 26 États et territoires du Pacifique, lors de la réunion du PROE.
À la suite des travaux menés par le groupe de travail Pelagic, co-financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) accompagné par son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), une étude a été menée sur l’impact des activités humaines sur les prédateurs marins. Elle a mis en évidence, dans une publication scientifique publiée le 6 août 2019 dans PLoS Biology, que les prédateurs marins se regroupent principalement sur des récifs isolés et des monts sous-marins situés à plus de 1 250 km des ports de pêche.
Cette étude a été menée par une équipe internationale, dirigée par la Société zoologique de Londres (ZSL), de 15 chercheurs de 12 instituts de recherche différents, parmi lesquels l’Université de Montpellier et l’IRD.
Consultez le communiqué de presse.
—
Références de l’article :
Letessier TB, Mouillot D, Bouchet PJ, Vigliola L, Fernandes MC, Thompson C, et al. (2019) Remote reefs and seamounts are the last refuges for marine predators across the Indo-Pacific. PLoS Biol 17(8): e3000366. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000366
—
Références de l’article :
Letessier TB, Mouillot D, Bouchet PJ, Vigliola L, Fernandes MC, Thompson C, et al. (2019) Remote reefs and seamounts are the last refuges for marine predators across the Indo-Pacific. PLoS Biol 17(8): e3000366. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000366
Publié dans PLoS Biology, le 6 août 2019
____
La pêche industrielle est en pleine expansion depuis les années 1950, et ce, à l’échelle mondiale. Le volume de la pêche industrielle représente plus de 80 millions de tonnes aujourd’hui, contre 20 millions en 1950. Au total, ce sont 55 % des zones océaniques qui sont exploitées par la pêche industrielle. Afin de remplir leurs filets, les pêcheurs doivent maintenant aller de plus en plus loin. Les derniers refuges de la faune marine, c’est-à-dire les espaces situés au-delà de la zone d’influence humaine détectable, sont ainsi de plus en plus rares. De vastes aires marines protégées (AMP), où la pêche est interdite, ont été établies depuis le début des années 2000 afin de préserver la biodiversité des océans. En 2015, les AMP atteignaient 3,4 % de la surface des océans mais nous manquons de connaissances sur la distribution globale de la biodiversité, de l’abondance et de la taille des prédateurs marins.
C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche, co-financée par la FRB et accompagnée par son Cesab, s’est attachée à analyser des données recueillies dans les océans Indien et Pacifique entre 2012 et 2015. La richesse (nombre d’espèces), la taille et l’abondance de plusieurs prédateurs marins, dont des requins, ont été estimées à l’aide de systèmes vidéo avec appâts sur plus de 1 000 sites. Aucun animal n’a été manipulé directement.
Publiés le 6 août 2019 dans PLOS Biology, les résultats démontrent que, bien que la richesse des espèces ne soit pas impactée par les activités humaines, la taille du corps et l’abondance des requins sont fortement corrélées avec la distance aux pressions anthropiques et notamment l’éloignement des ports de pêche. Ainsi, l’équipe de chercheurs a constaté que le nombre de requins diminuait de moitié dans les mers les plus proches des villes de plus de 10 000 habitants. Proche de l’Homme, la plupart des caméras n’ont pas enregistré la moindre présence de prédateurs qui, notamment les plus gros individus, se concentrent dans des zones situées à plus de 1 250 km des ports.
Malheureusement, comme les chercheurs le font remarquer, ces derniers refuges de prédateurs sont peu couverts par les AMP. Les travaux du projet Pelagic attirent donc l’attention sur la nécessité d’établir de nouvelles stratégies prenant en compte les habitats préférentiels des prédateurs marins, essentiels au maintien de la biodiversité dans nos océans et du fonctionnement des systèmes océaniques. Il s’agit d’établir au plus vite de nouvelles AMP comprenant des régions côtières comme des régions plus éloignées en mer.
L’auteur principal de l’étude, Tom Letessier (ZSL), a déclaré : “Seulement 13 % des océans de la planète peuvent maintenant être considérés comme “sauvages”, mais les requins et autres prédateurs sont beaucoup plus abondants et plus grands à des distances supérieures à 1 250 km des activités humaines. Cela suggère que les grands prédateurs marins sont incapables de prospérer à proximité des populations humaines et constitue un autre exemple clair de l’impact de la surexploitation humaine sur nos mers.”
Une biodiversité exceptionnelle peuple les cours d’eau et les eaux marines des outre-mer français. Près de 500 espèces de poissons évoluent dans les fleuves et criques de la forêt amazonienne de Guyane ; plus de 150 variétés de coraux composent les récifs de Mayotte et de La Réunion ; un millier de taxons de diatomées, algues microscopiques unicellulaires, habite le fond des cours d’eau des Antilles, de Mayotte et de La Réunion. Cette nature exubérante subit pourtant les pressions des activités humaines et peut en être fortement impactée. Les rivières des territoires insulaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion pâtissent notamment d’importants prélèvements d’eau qui réduisent drastiquement sa disponibilité pour la vie et la migration des espèces. Les activités d’orpaillage en Guyane induisent destruction du milieu naturel, asphyxient des rivières par les boues et pollution au mercure. À Mayotte, les détergents et lessives utilisées par les lavandières génèrent une pression chimique importante sur les invertébrés benthiques, organismes qui peuplent le fond des cours d’eau.
Pour rendre compte des altérations subies par les écosystèmes aquatiques et les communautés animales et végétales qui les composent, et ainsi pouvoir alerter et agir pour leur protection, la Directive cadre sur l’eau (DCE) a amené à développer des outils pour la surveillance des milieux aquatiques. Cette directive européenne, adoptée en 2000, vise à maintenir ou restaurer leur bon état écologique. En faisant des communautés biologiques les sentinelles de la qualité des eaux, elle a érigé la biodiversité en « juge de paix » de la surveillance et de la reconquête de l’état des rivières, des lacs et des eaux littorales.
Un des résultats majeurs de l’étude « Schémas spatiaux et temporels de blanchissement de masse des coraux pendant l’Anthropocène », publiée dans Science, est la mise en évidence de l’augmentation spectaculaire de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de blanchissement corallien qui atteignent des niveaux très élevés et quasiment irréversibles.
“L’état futur des récifs et des services écosystémiques qu’ils fournissent aux populations dépendra de manière directe de l’évolution de nos émissions de gaz à effet de serre et de notre capacité à renforcer la résilience des coraux au blanchissement par la gestion des facteurs de stress locaux”.
L’une des conséquences liées à l’augmentation des températures est le blanchissement corallien.
Le blanchissement se produit lorsque la densité des symbiotes algales, les zooxanthelles (Symbiodinium spp.), dans les tissus d’un hôte corallien diminue drastiquement à la suite d’un stress environnemental, révélant le squelette blanc du corail sous-jacent. La survie des coraux blanchis est alors compromise physiologiquement et nutritionnellement. Un blanchissement prolongé sur plusieurs mois conduit à des niveaux élevés de mortalité corallienne. La modélisation du climat mondial et les observations satellitaires indiquent également que les conditions thermiques requises pour le blanchissement des coraux prévalent de plus en plus, laissant présager que les zones de refuge, indemnes de blanchissement, pourraient disparaître au milieu du siècle.
Ces épisodes de blanchissement corallien, de plus en plus récurrents, et la mortalité des coraux qui en découle sont des phénomènes récents causés par l’impact anthropique. Ce qui, jusque dans les années 1980, n’était qu’un phénomène observable à l’échelle locale (quelques dizaines de kilomètres), causé par des facteurs de stress locaux (inondations d’eau douce, sédimentation ou encore temps inhabituellement froid ou chaud) est devenu un phénomène observable à l’échelle régionale (> 1000 km) et globale lié aux pressions anthropiques. C’est ce que révèle les bandes de croissance des coraux âgés des Caraïbes : les distorsions synchrones des dépôts squelettiques (bandes de stress) le long d’un tronçon de 400 km du récif mésoaméricain n’ont été trouvées que dernièrement suite aux conditions extrêmement chaudes.
Un des résultats majeurs de l’étude « Schémas spatiaux et temporels de blanchissement de masse des coraux pendant l’Anthropocène », publiée dans Science, est la mise en évidence de l’augmentation spectaculaire de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de blanchissement corallien qui atteignent des niveaux très élevés et quasiment irréversibles.
Telles sont les questions qui seront abordées lors des tables rondes et qui rassembleront scientifiques, acteurs professionnels et associations.
Ce colloque s’appuiera sur les expériences de terrain et sur les résultats des projets scientifiques financés par le ministère chargé de l’environnement dans le cadre du programme “Acidification des océans“.
Les documents stratégiques de façade font l’objet d’une consultation du public, qui s’ouvre aujourd’hui et jusqu’au 4 juin prochain sur : https://www.merlittoral2030.gouv.fr/
Cette consultation donne l’opportunité à toutes les parties prenantes de s’exprimer sur le contenu de ces documents, leur niveau d’ambition. Le niveau de participation est également révélateur de l’intérêt que la société porte aux enjeux marins. Les documents stratégiques de façade devraient ensuite être adoptés en septembre 2019.
1 minute pour comprendre la DCSMM avec Anastasia Wolff, chargée de mission « bon état écologique des eaux marines » au ministère en charge de l’environnement :
3 minutes pour comprendre l’impact des déchets en milieu marin avec François Galgani, responsable du groupe technique « déchets marins » pour la DCSMM :
3 minutes pour comprendre l’état écologique des espèces halieutiques commerciales pêchées dans les eaux métropolitaines par Éric Foucher, pilote scientifique « espèces commerciales » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :
3 minutes pour comprendre le coût économique et sociale de la dégradation du milieu marin avec Rémi Mongruel, pilote scientifique « analyse économique et sociale » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :
3 minutes pour comprendre l’état des mammifères marins dans les eaux métropolitaines avec Jérôme Spitz, pilote scientifique « mammifères marins » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :
L’exploitation non-durable des espèces est la deuxième cause du déclin global de la biodiversité, après le changement d’utilisation des terres. Elle est aussi probablement une des plus évidentes à résoudre, via des règlementations pertinentes. En se fondant sur les connaissances scientifiques, elles permettent de mieux gérer le prélèvement des espèces et d’ainsi assurer le renouvellement naturel des ressources. Le secteur des pêches notamment dispose de nombreux outils. Mais comme le révèle le cas des poissons d’eaux profondes, des mesures tardent parfois à être prises, mettant en danger les équilibres des écosystèmes et compromettant donc également la durabilité des activités.
Ses poissons vivant à plusieurs centaines de mètres de profondeur se sont retrouvés sur nos étals à la fin des années 1980. Les populations de morues, de lieus noirs et de merlus en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse connaissent un déclin de leur biomasse en raison de leur surexploitation, ce qui provoque une baisse de rentabilité des pêcheries françaises de haute-mer. Les chalutiers se tournent alors vers les espèces vivant plus en profondeur, entre 800 et 1 500 mètres, telles que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), le sabre noir (Aphanopus carbo) et l’hoplostèthe orange, ou empereur (Hoplostethus atlanticus) (Charuau et al., 1996). À la même époque, la consommation de poisson évolue vers une demande plus importante de filets de poissons au détriment de l’achat de poissons entiers. Cette évolution des modes de consommation permet la mise sur les marchés de filets de ces poissons d’eaux profondes, alors que présentés entiers, leur aspect aurait probablement été peu engageant pour les consommateurs. Plusieurs espèces de requins profonds sont quant à elles présentées sous forme de saumonette (requins étêtés, vidés et pelés).
Dès la fin des années 1990, certaines populations de poissons profonds montrent à leur tour des signes de déclin. Dans certaines zones, les captures d’hoplostèthes oranges, d’abord abondantes, se sont effondrées au bout de 12 à 18 mois d’exploitation seulement, révélant que pour cette espèce la pêche peut extraire une forte proportion de la biomasse1 en seulement quelques mois.
À mesure que le climat se réchauffe, les températures des mers augmentent également. Du plancton aux oiseaux, en passant par les poissons, ce phénomène modifie significativement toutes les composantes des écosystèmes marins. Un des effets les plus documentés de ce réchauffement est la migration des espèces vers les pôles, qui se traduit par une diminution de la biodiversité marine dans la zone intertropicale. Mais de nombreux autres facteurs influent sur les communautés d’espèces, notamment leur exploitation non-durable par la pêche. Cette dernière est alors responsable d’impacts très négatifs sur les populations de poissons, dont la diminution a aussi une incidence négative sur les oiseaux marins (Cury et al., 2011 ; Grémillet et al., 2018). Une proportion croissante de ces populations – un tiers des espèces pêchées en 2015 – est surexploitée, tandis que 60 % sont exploitées à leur maximum, et seules 7 % des populations sont sous-exploitées (FAO 2018). Or, l’océan reste une source essentielle d’approvisionnement en protéines pour des millions de personnes dans le monde, notamment dans les pays en développement.
Il est donc urgent de mettre en place une gestion soutenable des pêches, au moment même où les impacts négatifs du changement climatique rendent la tâche encore plus complexe : certains modèles prévoient une diminution de la biomasse des poissons allant jusqu’à 25 % d’ici la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre devaient s’intensifier (Lotze et al., 2018). Pour estimer les impacts des changements climatiques combinés à ceux des pratiques de pêche, une équipe de scientifiques menée par Caihong Fu (DFO, Canada) et Yunne-Jai Shin (IRD, France) a étudié neuf écosystèmes marins dans le monde entier. L’équipe s’est appuyée sur des modèles mathématiques développés pour chaque écosystème, et les a utilisés comme des laboratoires virtuels. En manipulant ces outils, les chercheurs ont pu explorer la manière dont le système évolue lorsque le changement climatique et la pêche entrent en interaction. L’objectif du projet est d’apporter un éclairage scientifique à la prise de décisions afin d’adapter les politiques de gestion des pêches au changement climatique.
En 2011, l’article de Cury et al. Global Seabird Response to Forage Fish Depletion — One-Third for the Birds soulignait combien les oiseaux marins étaient dépendants des ressources marines dans certaines régions du monde. Grémillet et ses collègues démontrent aujourd’hui que la compétition entre les oiseaux marins et les pêcheries est un facteur de stress significatif à l’échelle globale sur la période 1970-2010, pour une communauté mondiale d’oiseaux marins qui a décliné de 70 % depuis 1950 (Paleczny et al., 2015).
Le ministère de la transition écologique et solidaire a mobilisé une large communauté scientifique pour évaluer l’état écologique des eaux marines métropolitaines.
Le 9 novembre 2018, le colloque “bilan de santé des eaux marines” a donné la parole aux chercheurs mobilisés pour communiquer leurs principaux résultats. S’en est suivi une table ronde pour mettre en perspective les implications opérationnelles de ce bilan pour la gestion des écosystèmes littoraux et marins.
Le colloque a été suivi de la projection d’un film documentaire puis d’un temps d’échange entre le public et les experts présents.
Les Français consomment en moyenne plus de 30 kg par an de « poisson » (au sens commercial ou alimentaire, c’est-à-dire englobant poissons, mollusques et crustacés aquatiques). Dans l’Union Européenne, les ¾ de la consommation sont pêchés tandis qu’¼ est élevé, et à l’échelle mondiale, l’aquaculture assure un peu plus de la moitié de l’approvisionnement, le reste provenant de la pêche en eaux marines et continentales. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO)1 estime qu’1/3 des stocks2 halieutiques sont surexploités, c’est-à-dire soumis à une intensité de capture qui excède leur capacité à se renouveler. Si certaines espèces – telles que le thon rouge – se portent mieux grâce à des mesures de régulation de la pêche, d’autres sont au bord de l’effondrement et se retrouvent pourtant dans nos assiettes. Les travaux de recherche et rapports d’expertise scientifique peuvent cependant guider nos choix.
“Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation, 1/3 des stocks halieutiques sont surexploités.”
Préférer les poissons d’élevage à leurs équivalents sauvages n’est pas toujours une solution, car les seconds sont nécessaires pour nourrir les premiers. Plus précisément, plusieurs espèces de « petits pélagiques » sauvages (anchois, harengs, sardines, etc., aussi appelés « poissons fourrage ») entrent dans la composition de l’aliment des espèces carnassières d’élevage comme le saumon, ou encore les crevettes tropicales. Il faut un à plusieurs kg de poissons fourrage pour produire un kg d’une espèce d’élevage (dans le cas du saumon norvégien, environ 1 kg pour 1 kg). Les petits pélagiques « pèsent » près de 40 % des captures marines mondiales. Outre leur utilisation partagée, voire concurrente, entre fabrication d’aliments pour animaux d’élevage et consommation humaine (Majluf et al. 2017), ils sont aussi des proies indispensables aux prédateurs dans les écosystèmes marins.
Ainsi, la surpêche des petits pélagiques peut entraîner des conséquences dramatiques pour de nombreuses espèces de poissons, de mammifères et d’oiseaux marins comme le thon rouge de l’Atlantique, le manchot de Humboldt, le pétrel géant et la baleine à bosse (Pikitch et al. 2012, 2014). Or, les poissons fourrage, dont la vulnérabilité a été confirmée par des travaux scientifiques dans le cadre du projet Emibios, sont particulièrement affectés par les impacts combinés de la pêche et des changements climatiques (Travers-Trolet et al. 2014, Fu et al. 2018). Il ne faut cependant pas oublier que 30 % de la production aquacole mondiale de poissons d’élevage ne nécessite aucun apport d’aliment incluant du poisson fourrage : il s’agit en majorité de la carpe argentée et de la carpe à grosse tête. Il en est de même pour la culture des mollusques bivalves, principalement les moules, huîtres et palourdes.
Le maquereau et le hareng, ayant autrefois connu la surexploitation, auraient à présent des stocks suffisamment reconstitués pour que l’on puisse en recommander l’achat, d’autant plus que les qualités nutritionnelles des petits pélagiques sont avérées. Chez le poissonnier, plutôt que la dorade rose, classée comme quasi-menacée par l’Union internationale pour la conservation de la nature, il semblerait préférable de choisir la dorade grise ou la dorade royale3. Et plutôt que pour le thon rouge, dont l’état s’est certes amélioré mais reste fragile, mieux vaudrait opter pour la bonite à ventre rayé, également appelée « thon listao ». Les situations de ces espèces peuvent néanmoins basculer si les consommateurs ou les industriels se tournent trop massivement vers elles ! Pour acheter durable, le site www.ethic-ocean.org propose des guides pratiques et documentés, des fiches et une application mobile.
“Le label MSC est décerné aux pêcheries qui s’engagent à assurer une gestion durable des stocks afin d’éviter la surpêche.”
L’aquaculture étant assimilée à une activité agricole — ce qui n’est pas le cas de la pêche, les produits qui en sont issus peuvent être certifiés « Agriculture biologique », ce label ne tenant toutefois pas pleinement compte de leur incidence sur les écosystèmes marins. Concernant les poissons, mollusques et crustacés sauvages, le label MSC4 est décerné aux pêcheries qui s’engagent à assurer une gestion durable des stocks afin d’éviter la surpêche, et à ne pas détériorer les milieux aquatiques, par ailleurs très variés.
Car l’impact sur la ressource en elle-même n’est pas le seul qu’il faut considérer. Les fonds marins abritent les poissons dits « benthiques », à l’image des diverses espèces de raies, de soles et de plies (ou carrelets), ou encore de la baudroie commune, dont la queue est appelée « lotte ». D’autres poissons, dits « démersaux », vivent à proximité du fond, à l’instar du merlu commun5 et des différentes espèces de « gadidés », une famille de poissons dont le plus connu est la morue, ou cabillaud, et qui comprend également le merlan, le haddock et le colin d’Alaska (ce dernier atteignant le plus gros volume de capture parmi les poissons destinés à la consommation humaine).
La capture des poissons et de coquillages benthiques et démersaux nécessite des techniques qui raclent les sédiments marins (dragues et chaluts). La faune, constituée de coraux, d’éponges, de vers et de crustacés, est d’autant plus affectée que les engins pénètrent profondément dans le fond marin (Hiddink et al. 2017). Le temps mis par les écosystèmes pour se remettre des effets du chalutage varie entre près de deux ans et plus de six ans (Hiddink et al. 2017).
“La biodiversité de la petite faune est réduite de moitié dans les sédiments chalutés des grands fonds méditerranéens.”
Dans les sédiments régulièrement chalutés des grands fonds (-200 m et au-delà) du nord-ouest de la mer Méditerranée, la petite faune voit son abondance réduite de 80 % et sa biodiversité réduite de moitié (Pusceddu et al. 2014). Le renouvellement de la matière organique, processus crucial dans les écosystèmes benthiques, y est de 37 % plus lent. Or, le chalutage concerne des habitats toujours plus profonds, où l’impact est encore plus sévère et persistant (Clark et al. 2016). En Manche et au sud de la Mer du Nord, cette pratique affecte en particulier les espèces à durée de vie longue, du fait de leur croissance plus lente et de leur maturité plus tardive (Rijnsdorp et al. 2018). Cependant, pour certains poissons, plusieurs modes de pêche sont possibles. Mieux vaut alors choisir, par exemple, un bar de ligne plutôt qu’un bar de chalut.
Parmi les poissons dont les stocks sont largement surexploités figurent les espèces d’esturgeons (et leurs œufs, le caviar), l’espadon reconnaissable à son long rostre en forme d’épée, et surtout de nombreuses espèces de requins. D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un quart des raies et des requins sont fortement menacés d’extinction (Davidson et al. 2016, Dulvy et al. 2017). Il semble alors paradoxal que, selon la FAO, les débarquements (quantités rapportées au port) de requins et de raies aient décliné de près de 20 % en une décennie, après un pic en 20036.
“D’après l’UICN, un quart des raies et des requins sont fortement menacés d’extinction.”
En fait, si les pêcheurs capturent moins de requins et de raies, c’est bien parce que ces animaux se font plus rares dans les océans, et non parce que des mesures de régulation les y incitent ou obligent. En étudiant la situation dans 126 pays, des chercheurs ont en effet conclu que les débarquements de raies et de requins étaient étroitement liés à la demande des consommateurs, entraînant la pression de pêche sur les ressources, plutôt qu’à une meilleure gestion de leurs stocks. Ainsi, les pays présentant les plus forts déclins, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande, ont des côtes densément peuplées et exportent davantage de viande de raie et de requin (Davidson et al. 2016).
À l’heure où le commerce des produits issus de la mer est mondialisé et où 68 % des denrées alimentaires animales d’origine aquatique de l’Union Européenne sont importées (EUMOFA 2017), favoriser les produits locaux permet de diminuer le coût écologique du transport de l’océan à l’assiette. Et, à l’image des fruits et légumes, ils se consomment aussi de saison, selon leur période de reproduction (au cours de laquelle il faut éviter de les pêcher).
_______
1 Voir la récente édition du rapport biennal de la FAO (SOFIA 2018 : « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture), publié dans les 6 langues de l’ONU et téléchargeable à l’adresse :
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9540FR.
2 Le stock correspond à l’ensemble des individus d’une espèce susceptibles d’être pêchés, dans une zone géographique donnée.
3 Espèce carnivore sauvage, la daurade royale est aussi, avec le loup (ou bar), un produit « phare » de l’aquaculture en Méditerranée.
4 Le Marine stewardship council (https://www.msc.org/fr) est une ONG fondée par une entreprise, Unilever, et par le Fonds mondial pour la nature (WWF), mais indépendante de ces derniers depuis 1999. Aujourd’hui, 315 pêcheries sont certifiées MSC dans le monde, dont une dizaine en France.
5 Les merlus sont aussi appelés « colins », même s’ils sont assez différents du « colin d’Alaska » (gadidé).
6 Les captures de requins et de raies sont souvent déclarées par groupes d’espèces et non par espèce. On connaît des exemples où l’effondrement de l’une ou de plusieurs d’entre elles a été masqué par un report d’effort sur d’autres (Iglésias et al. 2010)
À eux seuls, ils abritent un tiers de la biodiversité marine connue. Ces zones sont de véritables nurseries pour les poissons récifaux et autres organismes marins. Plus de 500 millions de personnes dépendent de ces écosystèmes à travers la pêche, le tourisme, ou encore leur protection contre la houle. Tous ces services rendus ont un coût global estimé à 30 milliards de dollars par an.
La FRB, l’Institut océanographique de Monaco, le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (CRIOBE-CNRS-EPHE), la Plateforme Océan & Climat et l’Ifrecor ont organisé un colloque restituant les dernières connaissances scientifiques et les solutions de préservation.
Souvent trop fins ou usés, 70 % des détritus plastiques ne sont pas recyclés (Commission européenne 2017). Une grande part finit alors dans les milieux aquatiques. Empruntant les cours d’eau, ou disséminés à partir de décharges littorales, ils rejoignent les océans et les déchets qui s’y trouvent déjà, tels que les filets de pêche. Des chercheurs ont simulé ce processus pour déterminer l’ampleur de cette contribution (Lebreton et al. 2017). Ainsi, ils estiment que les rivières drainent chaque année dans les océans entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique. Les 20 rivières les plus polluantes constituent deux tiers de cette masse, la plupart d’entre elles se trouvant en Asie (Lebreton et al. 2017).
Dans le monde, la production globale de résines et de fibres plastiques est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 380 millions de tonnes en 2015. Sur cette période, 8,3 milliards de tonnes ont été produites au total, dont les trois quarts sont devenus des déchets (Geyer et al. 2017). Parmi les plastiques les plus couramment utilisés, aucun n’est biodégradable (Geyer et al. 2017). Les emballages en constituent une grande part, et leur recyclage reste à améliorer. Ainsi, on trouve des débris plastiques dans la totalité des principaux bassins océaniques.
“Dans les récifs envahis par les déchets plastiques, le risque de maladie des coraux est multiplié par 20.”
Certaines espèces, telles que les tortues marines, confondent ces déchets avec leurs proies. D’autres ingèrent des organismes eux-mêmes contaminés. Les récifs coralliens sont aussi particulièrement touchés par cette pollution plastique. D’après une équipe internationale dont les résultats sont parus cette année, le plastique favorise la colonisation des récifs par des microbes pathogènes (Lamb et al. 2018). L’étude, qui porte sur 159 récifs d’Asie et du Pacifique, montre que dans les récifs envahis par les déchets plastiques, le risque de maladie des coraux est multiplié par 20, accentuant ainsi la dégradation de cet habitat complexe qui héberge de nombreuses espèces de poissons (Lamb et al. 2018).
Rejetés à la mer, les grands débris de plastique sont soumis aux rayons UV, aux contraintes mécaniques des vagues et aux agressions biologiques qui progressivement les fragmentent en pièces de plus en plus petites (Cózar et al. 2014) : les « microplastiques » (moins de cinq millimètres), puis les « nanoplastiques » de moins d’un micron (millième de millimètre). Ces minuscules débris, formés d’une variété de composés1 et additifs2, agrègent des microorganismes et diverses molécules dont les polluants organiques persistants comme les PCB et certains pesticides. Ils sont facilement ingérés par les animaux marins, affaiblissant leur croissance et leur reproduction (Galloway et al. 2017). Des résultats expérimentaux récemment obtenus par des chercheurs américains (Allen et al. 2017) suggèrent qu’une espèce de corail filtre préférentiellement les particules de plastique non recouvertes d’un film microbien, les auteurs invoquant un effet « phagostimulant » (qui stimule l’alimentation).
“Les microplastiques sont facilement ingérés par les animaux marins, affaiblissant leur croissance et leur reproduction”
Les formes de vie microscopiques des océans réagissent également à la présence de ces déchets. L’expédition Tara Méditerranée, coordonnée par l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer (UPMC-CNRS), a recueilli un grand nombre d’échantillons marins. Dans une étude qui vient de paraître, des chercheurs de l’Observatoire océanologique de Banyuls (UPMC-CNRS) et leurs collègues ont montré, à partir de ces échantillons, que les débris plastiques en mer Méditerranée abritaient des communautés de bactéries différentes de celles qui vivent librement dans l’eau ou accrochées à des particules organiques (Dussud et al. 2018). Ces communautés forment un ensemble appelé « plastisphère ». Certaines bactéries ne peuvent vivre que sur des déchets plastiques et exploitent spécifiquement ce nouvel habitat (Dussud et al. 2018). De tels travaux sont essentiels pour mieux comprendre la façon dont les communautés microbiennes réagissent au plastique en milieu marin.

© Alexandra TER HALLE / IMRCP / CNRS Photothèque
“Microplastique, colonisé par une communauté bactérienne appelée biofilm, observé en microscopie électronique à balayage. L’image est colorisée. Le biofilm qui se développe sur le plastique est visible en couleurs. Les plus gros objets sont des diatomées. Ce débris de plastique a été collecté dans le gyre océanique de l’Atlantique nord, zone où s’accumulent les déchets plastiques flottants, en mai 2014 lors des expéditions 7e Continent. Le biofilm est une communauté bactérienne qui se développe sur les microplastiques flottant en mer, il a été baptisé “plastisphère”.”
_______
1 polyéthylènes (PE), polypropylènes (PP), chlorures de polyvinyle (PVC), polystyrènes (PS, dont expansé, EPS), polyuréthanes (PUR) et polytéréphtalates d’éthylène (PET). Au-delà de leur « durée d’utilité » variable selon l’usage – de relativement brève pour le packaging (PE, PP) à longue pour le bâtiment (PVC) –, ces matériaux deviennent des déchets à « longue durée de vie » omniprésents dans l’environnement en l’absence de recyclage.
2 tels que le bisphénol A, le nonylphénol et les phtalates.
Depuis près d’une quinzaine d’années, l’impact des crèmes solaires sur les coraux est dans le viseur des chercheurs. La première étude d’envergure remonte à 2008 (Danovaro et al. 2008). Les scientifiques se sont notamment penchés sur les zooxanthelles, qui vivent en symbiose avec les coraux. Ces petites algues ont pour particularité de tirer leur énergie des rayons du soleil par photosynthèse, et d’apporter aux coraux des nutriments essentiels. Si les algues meurent ou quittent la colonie de corail, cette dernière blanchit et succombe. L’étude, réalisée en laboratoire et in-situ dans différentes mers du monde, conclut que quels que soient le lieu et la concentration testée de crème solaire, cette dernière a systématiquement abouti à un rejet par les coraux de mucus contenant des zooxanthelles, rejet suivi d’un blanchissement complet dans les 96 heures (Danovaro et al. 2008). Un phénomène d’autant plus rapide que la température du milieu était élevée.
“Les larves de coraux exposées à l’oxybenzone s’ossifient de façon anormale et s’enferment dans leur propre squelette.”
En testant séparément différents composants présents dans les crèmes solaires, les auteurs ont montré que certains d’entre eux, des filtres organiques à UV comme le butylparaben et l’oxybenzone, se révélaient particulièrement néfastes, sans toutefois en expliquer le mécanisme précis. Or, selon une étude de Downs et al. (2016), à la lumière, l’oxybenzone détruit directement les zooxanthelles tandis qu’à l’obscurité, les coraux se mettent à les digérer. En outre, lorsque les larves de coraux sont exposées à cette substance, elles s’ossifient de façon anormale et s’enferment alors dans leur propre squelette. De plus, l’oxybenzone induit des lésions dans leur ADN. Les filtres minéraux (oxydes de zinc ou de titane) sous forme de nanoparticules seraient eux aussi toxiques pour la vie aquatique, car ils produisent des molécules appelées ROS (reactive oxygen species) qui détruisent les cellules (Lewicka et al. 2013 dans Wood 2018). Des études sont en cours pour évaluer leur effet sur les récifs coralliens (Tagliati et al. non publié, dans Wood 2018).
Il reste à savoir si les concentrations de crème solaire dans l’eau autour des récifs, probablement plus faibles que celles testées par les chercheurs en 2008, sont suffisantes pour entraîner de tels effets. Des études sont en cours. Cependant, certains blanchissements dans le monde semblent déjà ne pouvoir être expliqués que par la fréquentation des récifs par des touristes (Wood 2018). De prochaines études devraient aussi s’intéresser aux effets de ces produits à l’échelle de récifs coralliens entiers, voire d’écosystèmes, et non seulement aux effets distincts de chaque molécule, mais plutôt à leur « effet cocktail » lorsqu’elles agissent en mélange, comme c’est le cas en milieu naturel. Ces recherches seront cruciales : elles devront permettre de caractériser le risque de diminution de la résilience des coraux spécifiquement dû à ce stress écotoxicologique, sachant que les récifs sont déjà affaiblis par le réchauffement, l’acidification, ou encore par les ravages causés par l’étoile de mer Acanthaster, un redoutable « brouteur » de corail.
“Les récifs sont déjà affaiblis par le réchauffement, l’acidification, ou encore par les ravages causés par l’étoile de mer Acanthaster.”
Les filtres minéraux, lorsqu’ils ne sont pas formulés en nanoparticules, pourraient constituer une option plus favorable aux récifs – ce qui reste à confirmer par la science. Aujourd’hui, des crèmes solaires sont ainsi déclarées spécifiquement sans composants nuisibles aux coraux. Si aucun label n’existe encore pour certifier ces allégations, celles-ci marquent une volonté de certains industriels de prendre en compte l’impact de leurs produits sur la biodiversité. Cette démarche est à saluer.

© Lauric Thiault
Les récifs coralliens n’occupent que 0,1 % de la surface des océans, et représentent pourtant 30 % de la biodiversité marine mondiale. Les filtres contenus dans les crèmes solaires peuvent causer le blanchissement des coraux. Cependant, ce sont bien les changements globaux, avec la hausse des températures des océans, qui menacent le plus les récifs sur notre planète.
À l’instar des récifs coralliens des pays tropicaux, les récifs coralligènes, dénommés ainsi pour le corail rouge qu’ils abritent, ont tout pour devenir un emblème pour les pays côtiers Méditerranéens. En effet, la riche et belle biodiversité qu’ils abritent présente un intérêt de conservation en soi, mais aussi des avantages pour la pêche et le tourisme. Les connaissances sur ces écosystèmes sont longtemps restées parcellaires, mais se développent aujourd’hui, soulignant la beauté et la vulnérabilité de ces habitats.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.
De nombreux stocks de poissons des mers et océans du globe ont longtemps été – et sont encore – surexploités, notamment en Méditerranée. Cette surexploitation représente un gaspillage des ressources naturelles et aussi une menace pour la biodiversité. Cependant, des travaux de recherche montrent qu’une partie des espèces pêchées vont mieux, grâce aux mesures de régulation de la pêche. C’est le cas pour les thons rouges de Méditerranée et de l’Atlantique Est. Ces bons résultats ont d’ailleurs incité la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a autoriser l’augmentation des quotas de pêche pour cette espèce . La question posée est alors : « le thon rouge peut-il supporter cette augmentation des quotas » ?
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.
En 2015, l’offre de poissons, mollusques et crustacés (collectivement appelés « poisson ») a atteint le chiffre record de 20,3 kg par personne en moyenne. Le poisson demeure l’un des produits alimentaires de base les plus échangés au monde avec comme premier importateur l’Union européenne, devant les Etats-Unis, la Chine et le Japon.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.
La mise en place d’aires marines protégées est l’une des mesures phares de conservation de la biodiversité marine. Il s’agit principalement de définir un espace au sein duquel les activités humaines pourront être restreintes et la lutte contre la pollution renforcée, dans l’objectif de protéger un écosystème particulièrement remarquable ou sensible.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.
La Commission européenne, agissant dans le cadre du processus d’avis scientifique (Commission’s Scientific Advice Mechanism, SAM), a saisi son groupe de conseillers scientifiques de haut niveau sur la question “comment accroître l’extraction de nourriture et de biomasse d’origine marine sans compromettre les bénéfices des générations futures ?”.
Le groupe a entrepris ses travaux au début de l’année 2017 ; son rapport a été publié le 30 novembre 2017.
La note consultable ci-dessous comprend deux parties :
Les coraux peuvent fournir des informations sur les variations de certains paramètres au cours du temps, tels que la température des eaux de surface, la salinité ou encore la présence de pollutions d’origine humaine. Comment de simples échantillons de coraux permettent-ils de recueillir autant d’informations ?
Les coraux massifs du genre Porites sp. sont les plus fréquemment utilisés en paléoclimatologie. Ces organismes, vivant à faible profondeur, sont particulièrement sensibles aux variations physico-chimiques de leur milieu. Leur squelette calcaire, qui peut atteindre plusieurs mètres de diamètre, incorpore tout au long de leur croissance des éléments chimiques contenus dans l’eau de mer environnante. La radiographie de ce squelette permet d’établir la chronologie de leur croissance. Celle-ci se matérialise, à la manière des cernes d‘un arbre, sous la forme d’une alternance saisonnière de bandes sombres et de bandes claires de périodicité annuelle. Ainsi, l’analyse des éléments chimiques suivant l’axe de croissance du corail apporte des informations sur les variations des paramètres environnementaux et des pollutions anthropiques au cours du temps.

Radiographie d’un squelette calcaire de Porites (© IRD-C.E. Lazareth)
L’originalité de l’utilisation des coraux par rapport à d’autres archives (carottes sédimentaires ou de glace, stalagmites, etc.) réside dans leur précision temporelle ; en effet, ils permettent d’obtenir des données à une résolution plus fine, à l’échelle mensuelle. Par ailleurs, les Porites forment des colonies très denses à durée de vie longue. Celles-ci permettent de reconstituer des séries temporelles des variations environnementales qui dépassent parfois les 100ans. Grâce à certains fossiles datant du Trias, il est même possible de retracer les conditions climatiques et chimiques des océans pour des périodes géologiques très anciennes. Cela permet de valider ou de réfuter les résultats des modèles servant à estimer les variations futures du climat.
Une raison de plus pour protéger ces témoins du passé !
Accédez à la traduction de l’article scientifique :
Pourquoi un accord international sur la pollution de l‘océan par les plastiques est indispensable
Les plastiques s’accumulent partout dans le monde à un rythme croissant. D’après Geyer R. et al., si la tendance actuelle continue, 12 000 millions de tonnes de déchets plastiques seront mis en décharge ou dans l’environnement d’ici 2050.
Comme les gaz effet de serre ou les substances détruisant la couche d’ozone, les plastiques ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. Entraînés par le vent ou l’eau, ils finissent majoritairement leur course dans les océans affectant les organismes à tous les niveaux d’organisation biologique.
Cette pollution impacte les animaux marins (capture, étranglement, étouffement, etc.), avec des conséquences souvent fatales. Son action chimique, sous forme microscopique, agit également sur les organismes au niveau génétique ou fonctionnel (baisse de fertilité), les populations (diminution de la taille des populations) ou les communautés (déstructuration des relations entre les organismes constituant ces communautés).
Ces impacts, combinés à l’accélération de la production de plastique, ont amené un collectif de chercheurs à interpeler la communauté internationale pour prendre des mesures avant que les écosystèmes ne soient altérés de façon irréversible.
Le collectif demande à ce qu’un accord international définisse des objectifs pertinents et mesurables pour réduire la pollution plastique dans tous les océans du monde, car si des solutions ont été mises en place au niveau local, elles n’ont pas une ampleur suffisante pour faire face au caractère global d’un problème qui s’accroit très rapidement.
Ils demandent aussi que cet accord soit accompagné d’un programme visant à étendre la responsabilité des producteurs et l’intégration des coûts environnementaux dans le prix des produits, pour créer un fonds mondial, sur le modèle du fonds Climat de l’UNCCC, afin d’aider les Etats participants à développer les filières appropriées de traitement des déchets plastiques.
Ce programme permet de mobiliser 720 000 euros à destination des chercheurs français. Lancé en septembre 2015, l’appel à propositions de recherche a reçu 18 propositions. Huit projets couvrant les défis de recherche allant de la compréhension des impacts de l’acidification à leur modélisation, en passant par l’observation et la cartographie du phénomène ont été sélectionnés par le conseil scientifique ad hoc présidé par Jean-Pierre Gattuso du Laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-Mer. Ces projets reçoivent chacun 90 000 euros et associent de nombreux laboratoires et instituts de recherche, en France métropolitaine, en Polynésie française et à Monaco.
Les 8 projets financés sont les suivants :
Les conventions avec les porteurs des projets sont à présent presque toutes signées.
Le lancement du programme a lieu en parallèle du 4e atelier international sur l’impact économique de l’acidification des océans, consacré à l’écosystème corallien et organisé par le CSM et l’AIEA.
Découvrez, dans les ressources ci-dessous, les présentations des projets exposés ainsi que le compte-rendu du conseil scientifique qui s’est tenu ce même jour.
Les aires marines protégées ont un rôle majeur à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux changements globaux. En plus de préserver la biodiversité, une bonne gestion des réserves marines peut contribuer à l’adaptation des écosystèmes et des populations humaines aux cinq impacts majeurs du changement climatique sur les océans : l’acidification, la montée des eaux, l’intensification des tempêtes, les changements dans la distribution des espèces, la baisse de productivité et l’appauvrissement en oxygène. Les aires marines protégées peuvent même devenir des outils efficaces et peu coûteux pour réduire l’avancée du changement climatique. En effet, elles favorisent la séquestration et le stockage du carbone et constituent une « police d’assurance » pour les sociétés humaines en limitant les pressions directes sur l’environnement.
Parmi les effets positifs des aires marines protégées pour l’adaptation aux effets du changement climatique, on peut retenir que :
1/ la protection des zones littorales humides (mangroves, marais, herbiers) maintient une forte activité photosynthétique qui, en utilisant le CO2, réduit l’acidification des eaux. Ces zones constituent des refuges pour les organismes calcifiants.
2/ la création d’aires marines protégées en haute mer favorise la préservation d’une grande abondance des poissons téléostéens méso-pélagiques qui jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone.
3/ les aires marines protégées régulent les menaces telles que la surexploitation des milieux, l’urbanisation côtière ou le dragage non durable et sanctuarisent des zones tampons (zones humides côtières, les vasières et les récifs) qui protègent les infrastructures et les zones anthropisées contre l’élévation du niveau de la mer.
Parmi les effets positifs des aires marines protégées pour l’atténuation du changement climatique, on peut retenir que :
1/ les océans constituent un puits de carbone majeur. Les animaux jouent des rôles cruciaux dans les processus biogéochimiques. Les aires marines protégées contribuent ainsi à la préservation du rôle des océans dans la régulation du climat.
2/ les aires marines empêchent le déstockage du carbone en limitant des méthodes de pêche hauturières intensives – comme le chalutage – qui participent à la remise en suspension du carbone sédimentaire.
3/ les écosystèmes complexes favorisent des processus comme la dispersion des pollutions, la protection côtière, ou encore la production alimentaire tout en évitant les changements de régime des écosystèmes aux conséquences graves et inattendues.
C.M. Roberts et al., Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change, PNA 114, 6167-6175, 2017
Un article de synthèse signé par les plus grandes autorités mondiales en matière d’océanographie biologique – comme les scientifiques C.M. Roberts (Université d’York), J. Lubchenco, ancienne sous-secrétaire au commerce de l’administration Obama, D. Pauly (Université de la Colombie-Britannique) ou encore P. Cury (IRD et alors membre du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité) – démontrent comment les aires marines protégées contribuent à la fois à la préservation des espèces, à l’atténuation du changement climatique et à son adaptation. Pour que ces zones soient un outil efficace pour préserver les espèces et faire face au changement climatique, les scientifiques estiment qu’il faudrait protéger 30 % du domaine marin, or seuls 3,5 % sont actuellement couverts.
Les aires marines protégées ont un rôle majeur à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux changements globaux. En plus de préserver la biodiversité, une bonne gestion des réserves marines peut contribuer à l’adaptation des écosystèmes et des populations humaines aux cinq impacts majeurs du changement climatique sur les océans : l’acidification, la montée des eaux, l’intensification des tempêtes, les changements dans la distribution des espèces, la baisse de productivité et l’appauvrissement en oxygène. Les aires marines protégées peuvent même devenir des outils efficaces et peu coûteux pour réduire l’avancée du changement climatique. En effet, elles favorisent la séquestration et le stockage du carbone et constituent une « police d’assurance » pour les sociétés humaines en limitant les pressions directes sur l’environnement.
Parmi les effets positifs des aires marines protégées pour l’adaptation aux effets du changement climatique, on peut retenir que :
Parmi les effets positifs des aires marines protégées pour l’atténuation du changement climatique, on peut retenir que :
La synthèse complète est téléchargeable dans les ressources ci-dessous.