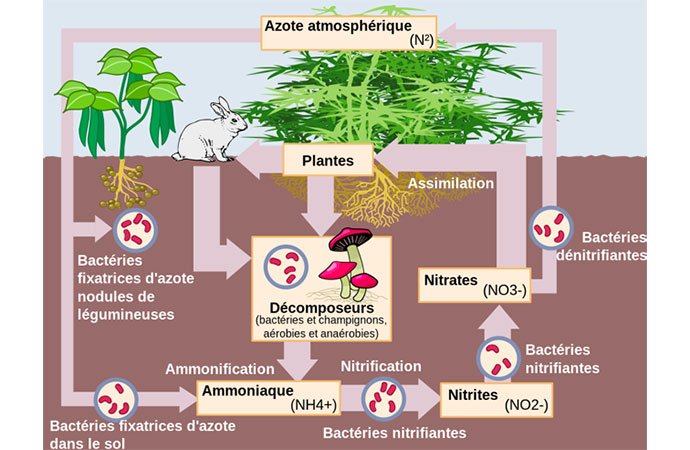Une biodiversité exceptionnelle peuple les cours d’eau et les eaux marines des outre-mer français. Près de 500 espèces de poissons évoluent dans les fleuves et criques de la forêt amazonienne de Guyane ; plus de 150 variétés de coraux composent les récifs de Mayotte et de La Réunion ; un millier de taxons de diatomées, algues microscopiques unicellulaires, habite le fond des cours d’eau des Antilles, de Mayotte et de La Réunion. Cette nature exubérante subit pourtant les pressions des activités humaines et peut en être fortement impactée. Les rivières des territoires insulaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion pâtissent notamment d’importants prélèvements d’eau qui réduisent drastiquement sa disponibilité pour la vie et la migration des espèces. Les activités d’orpaillage en Guyane induisent destruction du milieu naturel, asphyxient des rivières par les boues et pollution au mercure. À Mayotte, les détergents et lessives utilisées par les lavandières génèrent une pression chimique importante sur les invertébrés benthiques, organismes qui peuplent le fond des cours d’eau.
Pour rendre compte des altérations subies par les écosystèmes aquatiques et les communautés animales et végétales qui les composent, et ainsi pouvoir alerter et agir pour leur protection, la Directive cadre sur l’eau (DCE) a amené à développer des outils pour la surveillance des milieux aquatiques. Cette directive européenne, adoptée en 2000, vise à maintenir ou restaurer leur bon état écologique. En faisant des communautés biologiques les sentinelles de la qualité des eaux, elle a érigé la biodiversité en « juge de paix » de la surveillance et de la reconquête de l’état des rivières, des lacs et des eaux littorales.